22/06/2012
LA TRAGEDIE "PRINCE" (1934): UNE PISTE DE CROISSY A LA GENDARMERIE DE CHATOU

Les chansons de Lucienne Boyer, Albert Préjean, Fred Adison, Tino Rossi, Reda Caire eurent beau égayer le moral de l’année 1934, un seul mot, la crise, un faible mot, à remplacer par la décomposition morale et économique du pays, s’affichait. Ce ne fut pas une chansonnette mais un opéra tragique et sanglant que fredonnèrent les Français. Il avait pour nom l’affaire Stavisky, un fait divers qui aujourd’hui ne ferait peut-être plus les gros titres. Stavisky, dit « Serge Alexandre » en raison d’une carte d’identité délivrée par la préfecture de police en 1928 à ce faux nom, sévissait de longue date.
Arrêté à Marly-Le-Roi en juillet 1926 pour un cambriolage de 10 millions de francs de titres, il était sorti de prison pour « raisons de santé » l’année suivante. Ses escroqueries se dénombraient. L’homme était de nouveau arrêté sur la foi de rapports abondants – la police faisait bien son travail - mais la justice le libérait systématiquement. Plus de 80 dossiers sur son compte dormaient dans les antichambres des tribunaux.
Capable d’user et d’abuser de toutes les influences qui entouraient le pouvoir, Stavisky avait fini par accoucher de sa plus grande mystification : l'escroquerie autour des bons de Bayonne. L’un de ses complices, Gustave Tissier, le directeur du Crédit Municipal de Bayonne dont Stavisky était le fondateur, avait ainsi mis en circulation 239 millions de faux billets avec la bénédiction du député-maire président du conseil d’administration, Joseph Garat, maire radical de la ville de 1908 à 1919 et de 1925 à 1934.
Mais le 23 décembre 1933, Tissier fut arrêté et derrière lui, Garat, qui n’écopera que deux ans de prison. Le 7 janvier 1934, Stavisky fut retrouvé mort dans des conditions douteuses dans un chalet de Chamonix. Le titre du Canard Enchaîné est resté : « Stavisky s’est suicidé d’une balle tirée à trois mètres. Ce que c’est d ‘avoir le bras long ».

L’escroc Stavisky
Le ministre des Colonies, Dalimier, compromis, démissionna le lendemain. Raynaldi, le Garde des Sceaux, également lié à un ami de Stavisky, le banquier Sacazan, fit de même le 26 janvier. Le président du Conseil, Chautemps, dont le beau-frère, Pressard, était le chef du Parquet qui avait facilité la vie judiciaire de Stavisky pendant de nombreuses années, donna sa démission le 27 janvier 1934.
Le successeur de Chautemps, également radical, Edouard Daladier, composa son cabinet contre quelques concessions. Il prit des mesures contre les fonctionnaires réputés hostiles à la gauche. De curieuses promotions se mirent à pleuvoir. Le préfet de police de Paris, Jean Chiappe, fut nommé résident général au Maroc, le directeur de la Sûreté Générale, Thomé, devint administrateur de la Comédie Française cependant que coupable de ses libéralités judiciaires, Pressard fut nommé conseiller à la Cour de Cassation. Au rire et à l’indignation succéda la fureur populaire, à droite comme à gauche.
Mais ce furent les anciens combattants et les ligues d’extrême-droite qui descendirent dans la rue les premiers, engageant le 6 février 1934 prés de 40.000 manifestants au cri d’ « A bas les voleurs ». Une nuit d’émeute effroyable laissa sur le pavé 16 manifestants, un policier et fit un millier de blessés, prélude à la formation d’un « Front Commun » futur « Front Populaire ». Le 7 février 1934, Daladier démissionna. Il fut remplacé par Doumergue, qui créa une commission d’enquête parlementaire.

Entre-temps, le 7 janvier 1934, jour de la mort de Stavisky, fut interrogé un conseiller à la Cour du Parquet siégeant aux Assises, chef de la section financière, Albert Prince, par son supérieur, le premier président de la Cour d’appel, Eugène Dreyfus, le procureur de la République, Pressard, et deux autres membres du Parquet. On lui demanda ce qu’il avait fait des rapports de police de l’affaire Stavisky.
Pris de court et reçu à nouveau mais cette fois-ci par le premier président de la Cour de Cassation, Lescouvé, le 15 février 1934, il expliqua à ce dernier qu’il avait toujours transmis ses rapports au procureur Pressard, beau-frère du président du Conseil Camille Chautemps, mais que le procureur avait répondu qu’il verrait la suite à donner en finissant par lui demander de les classer dans le dossier Stavisky. Il déclara à Lescouvé : « je veux libérer ma conscience ».
Il fut convenu que le 18 février, Albert Prince lui remettrait toutes ses notes sur le dossier. Mais Lescouvé attendit en vain des nouvelles de Prince. Le 19 février, ce dernier siégeant normalement aux Assises entendait une jeune femme victime d’une tentative de meurtre sur une voie ferrée et lui posa des questions sur les conditions du choc avec le train. Il reçut une nouvelle note du président Lescouvé lui demandant son rapport et répondit qu’il n’avait pu consulter que tardivement le dossier Hudelo Cachard concerné, qu’il profiterait de la journée du 21 où il n’aurait pas d’audience pour rédiger la note demandée.
Le 20 février, Albert Prince quitta son domicile. Le 21 février 1934 aux environs de deux heures du matin, son cadavre fut retrouvé déchiqueté sur la voie ferrée traversant La Combe-Aux-Fées. Le conducteur du train qui l’avait découvert à 20h46 jugea qu’il l’avait écrasé. L’affaire Prince commença.
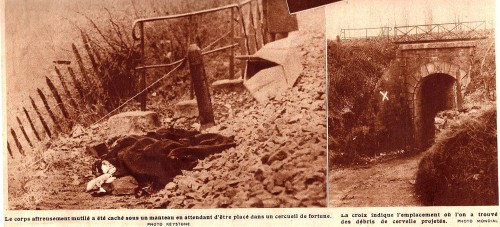
Ci-dessus, à droite, l’emplacement du corps mutilé, à gauche, l’emplacement des débris de cervelle du conseiller.

L’enquête à la Combe-Aux-Fées
Un commissaire de la Sûreté Générale, Monsieur Belin, arrivé à Dijon la nuit du 21 février 1934, déclara : « Messieurs, c’est un suicide ». Puis vint l’inspecteur chargé de l’enquête le 3 mars 1934 à la demande expresse du Garde des Sceaux Chéron, Bonny, missionné dans toutes les affaires criminelles et politiques. C’est lui qui officia en 1923 dans l’affaire Seznec, dont le principal chef d’accusation, une machine à écrire ayant servi à Seznec dans son grenier pour établir une promesse de vente en sa faveur de Quemeneur (assassiné), ne tient plus aujourd’hui.
Lorsqu’il fut désigné dans l’affaire Prince, Bonny faisait déjà l’objet plaintes déposées devant le Parquet pour ses méthodes de chantage et de corruption. Le 27 mars 1934 , il rendit un rapport concluant à un crime politique sans en apporter les preuves formelles en désignant trois gangsters, Carbone, Spirito et le baron de Lussats comme en étant les agents d’exécution potentiels.
Bonny fut révoqué de la police le 10 janvier 1935 puis condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis le 31 octobre 1935 par la Cour d’Assises de la Seine. Engagé dans la Gestapo pendant la guerre, il fut arrêté et fusillé non sans avoir affirmé qu’on lui avait demandé d’organiser la disparition de Prince pour éviter celle, politique, d’une partie de la classe parlementaire. Son témoignage, peu détaillé, jugé trop tardif et délivré à la veille de son exécution, est sujet à caution.
C’est peu après son rapport qu’éclata l’affaire Watson pour laquelle fut diligenté Monsieur Mondanel, de la Sûreté. Alors que les hypothèses les plus folles couraient au profit de la thèse du crime politique, l’une concernait Croissy. Elle partit du « château bleu », 3 avenue Gounod, occupé depuis 1925 par Monsieur Watson, milliardaire écossais et ancien représentant d’une compagnie pétrolière en France selon « L’Humanité ». Celui-ci louait une partie de sa villa à Monsieur Bruneau, son homme à tout faire.

Le « château bleu » tient manifestement son nom de l’agrandissement qui n’est pas sans rappeler les fastes de l’Exposition Universelle de 1855 de Londres. Photo prise avec l’aimable autorisation de Monsieur et Madame Imgal.
« L’Action Française » du 16 avril 1934 rapporta : « un américain, Monsieur Watson, qui sous-loue une aile de sa villa de l’avenue Gounod à l’amie d’un certain Monsieur Bruneau, industriel parisien, déclara, il y a quelques jours, à la gendarmerie, que cet industriel, à l’issue d’un bon dîner , lui avait avoué avoir, sur l’ordre de l’inspecteur Bonny, exécuté, à la frontière italienne, l’assassin du conseiller Prince, un nommé Fontaine.
Hier après-midi, le parquet de Versailles, composé de Messieurs Albert, substitut, et Pihier, juge d’instruction, s’est rendu avenue Gounod. Il était prés de 16 heures quand les magistrats de Versailles se présentèrent sur le seuil de l’opulente villa où demeure l’américain Watson. Les magistrats restèrent fort peu de temps avenue Gounod. Ils quittaient la villa vers 16h15, accompagnés de Monsieur et Madame Watson, ainsi que de Monsieur Bruneau. Un départ en voiture suivit pour le palais de justice de Versailles, annonça-t-on, mais à 17h30, on n’avait dans la capitale de Seine-et-Oise, pas connaissance de l’arrivée des magistrats et des témoins.
Ces derniers étaient en réalité à la gendarmerie de Chatou où ils étaient entendus. A la suite de l’interrogatoire qu’il a subi pendant tout l’après-midi à la gendarmerie, Maurice Bruneau, 23 ans, se disant marchand d’automobiles et demeurant à l’Hôtel des Ibis, au Vésinet, a été inculpé de tentative de meurtre sur X et placé sous mandat de dépôt. Monsieur et Madame Watson ont regagné leur domicile avenue Gounod à Croissy.
Monsieur Bruneau, qui est originaire de Montbazon, aurait fait aux magistrats les déclarations suivantes : le 3 avril dernier, alors qu’il se trouvait avec Monsieur et Madame Watson, à Monte-Carlo, il avait été accosté par deux individus dont il ne put fournir l’identité et qui lui avaient tenu à peu prés ces propos : « tu es en parfaites relations avec un riche anglais. Tu devrais l’obliger à apporter une somme de 500.000 francs et le faire venir à un endroit que nous fixerons pour le dévaliser. Sur cette somme, il va sans dire que tu aurais une très forte commission. »
Monsieur Maurice Bruneau s’empressa d’avertir Monsieur Watson qui, pensant que sa vie était en danger, quitta la Côte d’Azur pour réintégrer sa propriété de Croissy-Sur-Seine. C’est depuis ce moment qu’il est l’objet de menaces de mort de la part d’individus anonymes. Bruneau, poursuivant ses déclarations, a dit qu’il se rendit au rendez-vous fixé par les deux malfaiteurs. Il les vit dans une luxueuse automobile. L’un était assis à l’intérieur et l’autre au volant.
- Me voyant arriver seul, a dit Bruneau, les deux malfaiteurs comprirent que j’avais dû les trahir. A peine étais-je assis dans la voiture que je fus assommé à coups de matraque. Lorsque je revins peu à peu à moi, j’entendis les deux hommes qui faisaient allusion à l’assassinat du conseiller Prince. Pensant sans doute que j’étais toujours étourdi, les deux individus poursuivirent leur conversation, mais brusquement je tirai mon revolver de ma poche et fis feu sur l’individu qui était à mes côtés.
Je dus le blesser, car je le vis cracher du sang. Je retournai alors mon arme dans la direction du conducteur, mais mon revolver s’enraya. Le complice de ma victime, me voyant armé, arrêta sa voiture et me jeta hors de l’automobile en criant : « tu as de la chance de t’en tirer ainsi. Il vaut mieux que tu t’en ailles ». Je vis alors l’autre automobile disparaître dans la direction de la frontière italienne. J’ignore si j’ai tué l’individu sur lequel j’ai tiré et ne puis donner d’autres précisions.
A la suite de ces déclarations, Maurice Bruneau a été inculpé de tentative de meurtre par Monsieur Pihier, juge d’instruction, qui l’a placé sous mandat de dépôt. Maurice Bruneau va être transféré sous peu à la prison de Versailles. D’après l’enquête faite par la Sûreté Générale, tandis que Monsieur et Madame Watson se trouvaient à Monte-Carlo, ils auraient été mis en rapport avec le baron de Lussats et Carbone.
Le baron de Lussats, le 23 février, se serait livré à une agression sur Monsieur Watson, qui aurait refusé de lui prêter 25.000 francs. La Sûreté Générale va donc poursuivre son enquête pour retrouver la trace du blessé et de son complice.
Monsieur Mondanel, contrôleur général par intérim des recherches judiciaires à la Sûreté Générale, est allé dans la soirée à la gendarmerie de Chatou, où il a pris connaissance des procès-verbaux relatant les déclarations de Maurice Bruneau. A sa sortie vers 22 heures, Monsieur Mondanel a déclaré : « l’affaire s’annonce comme très intéressante si les faits sont vérifiés. Attendons. »
Bruneau aurait donné, au cours de l’interrogatoire qu’il a subi hier soir, une nouvelle version de l’histoire de malfaiteurs qu’il a rapporté l’après-midi. Voici les faits : Monsieur Watson serait allé en personne au rendez-vous que lui avait fixé le mystérieux personnage.
Cependant, mis en méfiance, le riche écossais aurait prié Bruneau de l’accompagner. Il fut ainsi fait. Au rendez-vous, Bruneau et Watson trouvèrent plusieurs hommes ayant l’accent italien et parmi eux, il y avait un nommé Fournier. L’entrevue eut lieu puis la demande d’argent à Monsieur Watson. C’est alors que Bruneau entendit cette phrase, qu’échangeaient deux bandits : « le jour où tu as supprimé Prince, tu avais moins la frousse. » Bruneau alors prit peur, voyant dans quel guet-apens lui et Watson étaient tombés.
C’est alors qu’il aurait sorti son revolver et tiré par quatre fois, blessant le nommé Fournier. Tout l’intérêt - et c’est à quoi s’attache le commissaire, Monsieur Jobard -, serait de prouver que la scène de terrorisme qui a eu pour théâtre le 4 avril la Côte d’Azur, peut être rattachée à l’affaire Prince.
A cet effet, les noms du baron de Lussats, très connu de Marseille à Monaco, et de l’inspecteur principal Bonny, aux indicateurs nombreux et « deus ex machina de l’affaire », selon l’expression d’un membre du Parquet de Dijon, prononcée par Monsieur Bruneau, ne suffisent évidemment pas. Il faut attendre et observer le développement de ce nouvel épisode d’une affaire criminelle qui en déjà eu beaucoup. »
Le lendemain, « Le Matin » écrivit que les aveux de Maurice Bruneau ne soulevaient pas d’émotion à Monte-Carlo. « Ceux qui le connaissent écoutent l’histoire en souriant et portent un doigt au front ». Le propriétaire de l’hôtel Lido à Monte-Carlo, Monsieur Webel, témoigna : « ce Bruneau me fit tout de suite l’impression d’être un fou. Il occupait une chambre voisine de la mienne. Je n’ai jamais eu locataire semblable. Je crois qu’il ne se couchait jamais. La nuit, il sortait de sa chambre pour faire les cent pas dans le couloir. J’allumais alors la minuterie et il rentrait précipitamment chez lui, mais pour ressortir presque aussitôt. »
Le valet de chambre, Antoine, acheva le tableau : « presque toutes les nuits, Monsieur Bruneau sortait plusieurs fois. Je le trouvais l’air égaré, un revolver à la main. Il prétendait qu’on avait tenté de s’introduire dans sa chambre par la fenêtre. Je réussis bien à le calmer pendant quelques temps en lui parlant doucement et en lui démontrant que personne ne pouvait l’inquiéter ; mais dans la nuit du 2 au 3 mars, il eut une crise qui me terrifia, il sonna comme d’habitude, et , quand je me présentai, il ne me reconnut pas : « qui êtes-vous », me demanda-t-il, « et que venez-vous faire ici ? »
Le 18 avril, « Le Matin » indiquait que le médecin légiste, le docteur Détis, après examen de Bruneau, ne constatait aucune trace d’un coup sur la tête, au moins concernant son agression, mais ne pouvait non plus l’exclure.
L’inspecteur Bonny, qui était le seul enquêteur à avoir conclu un crime, déclara au journal qu’il ne connaissait ni Bruneau ni Fournier dont Bruneau prétendait être l’assassin « et que celui-ci ne peut, par conséquent, être l’un de mes indicateurs. Quant à Monsieur Watson, je ne le connais pas davantage mais son nom me dit cependant quelque chose. A première vue, cette histoire ne me semble pas avoir de rapport quelconque avec l’affaire Prince. »
Quant au juge d’instruction Pihier, il s’exaspéra de l’attitude des protagonistes. Madame Watson prétendit qu’elle n’avait jamais entendu parler de son agression à Monte-Carlo. Lorsque le juge la confronta à Bruneau, celui-ci répondit qu’il ne savait pas « si Monsieur et Madame Watson étaient à table lorsqu’il fit sa déclaration », ce qui contredisait le témoignage de Monsieur Watson et la première déclaration que Bruneau avait faite.
Œuvre d’un fou plus qu’une manipulation, le témoignage de l’affaire Watson ne fut corroboré par aucun élément.

« L’Ouest Eclair » du 18 avril 1934 titra en gros caractères « On continue de suivre la piste de Chatou » (la gare de Chatou a longtemps fait du tort à Croissy…) et ajouta en-dessous en petits caractères, non sans effet comique, « mais c’est sans conviction ».
La vérité sur l’affaire Prince put-elle être apportée ? les témoignages les plus graves et les plus pittoresques dont celui de Croissy avaient circulé, sous le regard déçu de l’opinion publique. Mais celle-ci pouvait-elle espérer un résultat propre à encombrer les allées aussi tourmentées que démissionnaires du pouvoir ? fallait-il réellement voir une œuvre de commande dans le piétinement de l’enquête ou Prince se suicida-t-il comme le conclut la thèse officielle ? en effet, si victime il était en ayant obéi à des consignes, il était encore possible à Albert Prince de démontrer sa bonne foi, de produire ses documents, d’en garder copie pour la presse, de parler. Or, malgré la demande de son supérieur, il ne fit rien et laissa passer du temps, peut-être aussi parce qu’il s’estimait en danger prétendront les partisans de l’assassinat. Il continua ses audiences, comme si de rien n’était.
Le départ du magistrat à Dijon est troublant. Sa femme avait reçu un appel le 20 février 1934 qu’elle croyait être du médecin de la mère du conseiller, demandant à son mari de se rendre à Dijon pour décider de l’opération de sa belle-mère. Albert Prince était rentré chez lui peu après l’appel téléphonique et avait décidé de partir par le train sur le champ.

Pourquoi alors Albert Prince avait-il, le jour même, envoyé un télégramme de Dijon à sa femme – il fut identifié par des témoins à la gare en train d’écrire un télégramme - en précisant que le docteur « Hallinger » déclarait sa mère guérie alors que celle-ci n’était pas malade et que le vrai nom de son médecin était le docteur « Ehringer » ? enfin, comment se fait-il dans l’hypothèse d’un assassinat, que le corps n’ait pas été attaché solidement à la voie, et que l’on retrouva seulement une ficelle entourant la cheville du conseiller ? Pourquoi, alors que le président Lescouvé lui demandait son rapport depuis cinq jours, ne prévint-il personne au Parquet de son départ pour Dijon ?

Cet homme, soldat héroïque, dont la probité n’était pas mise en doute, qui gérait des centaines de dossiers chaque année, ne s’était-il pas senti coupable d’une négligence dont l’oppression lui avait parue insupportable ? avait-il simplement obéi à des consignes orales, dès lors impossible à prouver ?
Le 16 février 1934, le député de Gironde et natif de Chatou, Georges Mandel (ci-dessous), déjà célèbre pour être le champion de la dénonciation de l’inertie face au réarmement allemand, se retrouva propulsé procureur devant ses collègues, au titre de la commission d’enquête parlementaire Guernut sur l’affaire Stavisky, dont il mena les interrogatoires. La commission n’était pas munie de pouvoirs judiciaires et s’intéressait aux seules complicités de Stavisky. Elle communiqua à partir du mois de mars 1934 des dossiers des parlementaires mis en cause.
Malgré vingt-six dossiers transmis, aucune suite ne fut donnée. Georges Mandel prit à partie en août 1934 le Garde des Sceaux, Chéron : « il n’y aurait qu’une seule façon de parvenir à l’apaisement, c’est la recherche et la punition des coupables. C’est ce que Monsieur Chéron ne veut pas et ne fait pas ».
Mais au sujet de l’affaire Prince, il livra sa conviction dans le journal « Le Cri du Jour » dans son édition du 31 mars 1934 : « je ne crois pas qu’un homme politique important ait jamais donné l’ordre de faire disparaître Monsieur Prince. Dans l’état actuel de notre personnel gouvernemental, nous n’avons pas un seul homme capable de donner un ordre quel qu’il soit. » Georges Mandel se plut surtout à démontrer les liens de Stavisky avec la classe parlementaire.
Citons ses questions du 6 juillet 1934, posées au député Bonnaure, député et avocat de l’aventurier : « A l’occasion du congrès radical-socialiste de Toulouse en 1932, « La Volonté » n’a-t-elle pas fait un très grand effort de lancement ? – Si – Elle y a consacré des sommes importantes ? – Oui – Etait-ce, pour partie, grâce au concours de Stavisky ? – Oui ».
Le clou fut peut-être la déposition de l’inspecteur Bayard de la Sûreté Générale qui employa Stavisky comme indicateur de 1928 à 1932, soit dans la période où il organisa ses escroqueries avec un ancien préfet de police, Monsieur Hudelo. Georges Mandel entendit également le témoignage d’un conseiller à la Cour, Monsieur Glard, qui déposa le 13 août 1934, sur les propos que Prince lui avait tenus : « j’étais écoeuré des interventions parlementaires et des résultats qui suivaient ».
Le président Lescouvé avait lui aussi rapporté devant la commission d’enquête le 10 avril 1934 que le magistrat lui avait déclaré : « J’en sais trop sur l’affaire Stavisky et sur d’autres ».
Georges Mandel était manifestement revenu à la charge la thèse de l’assassinat en tête : ce même 10 avril, il interrogeait le président Lescouvé en ces termes : « une campagne de presse, savamment orchestrée, tente de réaccréditer la thèse du suicide de Monsieur Prince. Dans les journaux de ce matin, on peut lire un document d’après lequel Messieurs Prince et Pressard auraient été convoqués devant la commission présidée par Monsieur Lescouvé, non comme témoins, mais en quelque sorte comme prévenus. Qu’en pensez-vous ? ».(…).

Georges Mandel photographié en voiture en couverture du journal «Les Annales » du 2 mars 1934 en tant que membre de la Commission d’Enquête Stavisky, "un des membres les plus redoutés" annonce le journal. Le futur ministre des PTT était né 10 avenue du Chemin de Fer à Chatou en 1885.
Madame Prince témoigna quant à elle que le 20 février, jour de la mort du conseiller, son téléphone ne marchait pas, qu’après le départ de son mari, elle chercha à téléphoner dans la journée puis dans la soirée à divers membres de sa famille et qu’elle dut refaire cinq à dix fois le numéro avant d’obtenir la communication. Cela laisserait supposer que la ligne était sur écoute.
Le 23 octobre 1933, Stavisky avait encore bénéficié d’une remise pour une affaire de vol sur la foi d’un certificat médical des docteurs Marie et Vachet : « n’est pas en état en ce moment d’affronter un débat judiciaire qui pourrait déterminer un choc émotionnel. »
Un membre de la commission d’enquête, Ernest Lafond, interrogea le docteur Marie, de l’hôpital Sainte-Anne : Lafond : « L’examen a eu lieu à l’asile ? » - Marie : « Chez moi, boulevard Edgard Quinet 16. » - Lafond : « Comment se fait-il qu’il y ait le tampon de l’asile ? » - Marie : « J’y vais assez souvent et ne me souviens pas si la pièce a été signée à l’asile ou chez moi. » - Lafond : « Pourquoi aviez-vous apposé également le tampon de la mairie d’Orly ? » - Marie : « Je l’avais mis pour identifier ma signature. Je suis maire d’Orly. » Lafond : « Vous avez mis tous les tampons que vous aviez sous la main ? » (…).
Le commissaire Guillaume, qui hérita de l’enquête au titre de la police judiciaire, reprit l’affaire depuis l’origine et précisa dans son rapport du 16 août 1934 : « Le 27 mars 1934, Monsieur l’Inspecteur principal de la police mobile Bonny qui, le 3 mars, avait été chargé de découvrir les assassins du conseiller Prince, a déposé un rapport dans lequel il concluait à un crime politique.
Se rapportant aux dires, non contrôlés de deux de ses indicateurs, Monsieur Bonny désignait comme étant au courant ou ayant participé à ce crime : L’Herbon de Lussats Gaëtan dit Baron, né le 8 août 1888 à Monaco, de feu Henri et de Berrier Marie, Spirito, François Paul dit Le Grand Lydro, né le 22 janvier 1900 à Marseille, Carbonne Paul Bonaventure dit Venture, né le 14 février 1894 à Propriano (Corse).
Ce rapport a été communiqué au Parquet de Dijon. Un mandat d’amener fut délivré contre les trois individus sous les trois inculpations d’assassinat, vol et complicité. Ces trois individus arrêtés et transférés à Dijon ont été entendus, confrontés avec de nombreux témoins, mais deux d’entre eux furent relaxés, et peu après le troisième (de Lussats) fut transféré à Paris et ensuite à Nice pour autre cause. A l’heure actuelle, la preuve n’a pu être faite qu’ils étaient les auteurs ou les complices de ce crime.
Malheureusement, cette piste fit perdre un temps précieux aux premiers enquêteurs et pesa fâcheusement sur la suite de l’enquête. Il est, du reste, à noter que les recherches effectuées au sujet de la mort du conseiller Prince sont encore faites actuellement en vertu de l’inculpation pour assassinat contre ces trois individus, pour lesquels aucun non lieu n’a été prononcé à ce jour. L’enquête sur l’emploi du temps de Herbon de Lussats, Carbonne, Spirito a été effectuée par Monsieur Bonny qui a convenu depuis que ceux-ci ne pouvaient être les auteurs du crime, mais qu’ils ont pu en connaître tous les détails ».

Le commissaire Guillaume
La thèse de l’assassinat du magistrat, qui ne fut pas admise dés le début de l’enquête, fut ensuite poursuivie non seulement par la police française mais par les journaux, qui s’adjoignirent les services de membres de la police britannique et de détectives privés, par Georges Simenon, déjà créateur de Maigret, qui rencontra des truands dont le baron de Lussats ! cette thèse, qui avait le soutien de toute la magistrature et d’une partie de la presse, reste en suspens.
Le 16 septembre 1934, le journaliste Géo Guasco, de l’hebdomadaire « Police Magazine », annonça comme une partie des journaux ce fait cruel : les rapports des enquêteurs concluant au suicide n’avaient pas été publiés pour ne pas froisser l’opinion. Or ceux-ci émanaient de :
- la Sûreté Générale qui s’appuyait sur l’enquête du commissaire Belin
- la Police Judiciaire se fondant sur le rapport du 16 août 1934 du commissaire divisionnaire Guillaume (1871-1963). (considéré comme le plus grand policier de France, celui-ci inspira le personnage de Maigret à Simenon).
- l’ex-brigadier Riboulet, détective engagé par « Le Matin », auteur de l’arrestation de Landru, et dont le rapport sur l’affaire Prince ne fut jamais publié pour éviter la perte des lecteurs
- les détectives anglais de Scotland Yard
- l’enquête semi-officielle menée par l’inspecteur Yves Le Gall et le journaliste de « Police Magazine »
Le journal « Détective » du 30 août 1934, qui rapporta les conclusions du commissaire Guillaume, ne manqua pas de mentionner que celui-ci n’appartenait à aucun club, aucun groupe politique, de même que ses collaborateurs, l’inspecteur principal Moreux et le brigadier-chef Piguet (cf couverture ci-dessous de Police Détective montrant Guillaume au centre, Moreux et Piguet à ses côtés).

800 témoins furent entendus, 850 pour vérifier ce qui s’avéra être un faux-témoignage d’un dénommé « H.V. » Au total, les inspecteurs et commissaires-enquêteurs diligentés dans tous les services étaient au nombre de soixante. Le journal fit état en outre des faiblesses du Parquet de Dijon, poursuivant le crime : aucune saisine de la locomotive alors que celle-ci relevait selon le conducteur des débris de cervelle humaine à sa rentrée au dépôt, ce que le Parquet contestait.
Or, un ingénieur des chemins de fer précisa : « l’enquête mécanique donne à conclure que le corps était placé dans l’écartement des rails et dans une position telle que la tête arrivait à hauteur du crochet de traction : or, un corps humain ne peut avoir cette position que s’il est libre de ses mouvements.(…) On ne doit pas s’étonner de voir des traces de chair et de sang encore adhérents à la locomotive après 160 kilomètres de course ; c’est là aussi un phénomène très normal et semblable à celui des moucherons écrasés sur le pare-brise d’une auto qu’il faut, à l’étape, enlever à l’éponge. »
Au sujet de la locomotive, le procureur de la République de Dijon écrivit le 23 août 1934 au procureur général de la cour d’Appel : « j’ai rappelé que le juge d’instruction avait, dès le 21 février au matin, fait le nécessaire pour que l’examen de la locomotive fut entrepris judiciairement, mais cette machine avait été remise en service par le dépôt de Dijon dans la nuit du 20 au 21 février et avait remorqué un train de Dijon-Perrigny à Laroche-Mijennes.
Ce n’est qu’à cette dernière station que la gendarmerie, le mécanicien et le sous-ingénieur Girard, d’accord dans leurs déclarations, firent connaître l’état de la locomotive. Dans ces conditions, une expertise qui devait porter sur une machine ayant parcouru 175 kms avant d’avoir pu être saisie fut jugée non pertinente. »
Quant au couteau ensanglanté retrouvé prés de la voie, un témoin l’identifia comme ayant été acheté au B.H.V d’un homme vu de dos du genre de Prince ou de Bonny, le témoin insistant sur un homme plutôt jeune de 40 ans alors que Prince en avait plus de 50. Mais le rapport Guillaume attribua l’achat à Prince. Plus de 20 personnes ayant touché ce couteau lors de l’enquête sans consigne du Parquet, les experts devinrent incapables de se prononcer sur son usage antérieur.
S’agissant de l’état personnel de Prince, qui n’avait pas été pris en compte par le Parquet, il révéla que le secrétaire du chef de la section financière et Madame Nollin, amie de la famille, le déclaraient désemparé et profondément affecté le 19 février. Un auteur, ami de la victime, Alfred Détrez, émit les plus vives réserves sur Madame Nollin, parce qu’elle était elle-même l’échotière de Madame Sée, amie de la femme du procureur Pressard.
En outre, ces témoignages contredirent la conversation de Madame Buteau avec le conseiller le matin du lundi 19 février 1934. La fille de Madame Buteau était la petite amie du fils du conseiller, Raymond Prince : Madame Buteau : « Pour le cinéma vous chargez vous de prendre des places ? » - Prince : « Oui, c’est moi qui retiendrai. J’ai prévenu les Simon. Je me réjouis de cette soirée. Tâchez de ne pas avoir sommeil, ni l’un ni l’autre, pour que nous puissions faire ensuite une petite bombe. »
Madame Buteau :« A part ça, qu’est ce que vous devenez ? où en sont vos affaires ? » - Prince : « J’en aurais trop à vous raconter. Ca va barder ! soyez tranquille. Je les tiens. Du reste, nous en parlerons jeudi. » Madame Buteau écrivit au commissaire Guillaume pour être entendue. Elle ne fut jamais interrogée.
Un témoignage s’oppose à la conclusion du suicide : celui de Madame Marin, qui écrivit le 18 septembre 1934 à la mère du conseiller Prince sur ce qu’elle avait vu sur le Chemin des Corviottes, à proximité de La-Combe-Aux-Fées :
« Madame, je maintiendrai toujours que le 20 février à 6 heures moins le quart du soir, j’ai rencontré sur la route nationale Bas-de-Talant trois automobiles qui se suivaient, dont celle du milieu, une petite auto grise foncée. Dans la première voiture, il y avait quatre occupants.
Dans la petite voiture grise qui s’était arrêtée à mes pieds, j’ai pu apercevoir un homme qui me criait : à moi, par deux fois en m’apercevant ; et tout de suite, l’homme qui était à côté de Monsieur Prince, que j’ai reconnu d’après les photographies du Bien Public, cet homme à côté de lui le repoussait au fond de la voiture en lui disant : « mais non, mon vieux » par deux fois. J’ai essayé de voir, mais cet homme me bouchait la vitre avec ses épaules et un large chapeau gris.
Et avant que la voiture se remette en marche, cet homme m’a lancé un regard de menace et de brigand. Malgré moi, j’ai dû reculer et j’étais seule ne pouvant aider à celui qui me demandait du secours, et ne pensant pas que c’était une affaire pareille. L’homme qui le repoussait était un petit homme de larges épaules, un visage rond et une figure mate. La première voiture était noire, la seconde était grise foncée, petite voiture basse, où le malheureux me demandait du secours, la troisième était noire.
J’ai bien regardé le numéro, mais je n’ai pas pu m’en souvenir, et si je n’ai fait connaître tout de suite j’ai bien fait connaître la raison dans mon rapport à Monsieur Rabut, juge d’instruction, que j’avais peur de représailles. Ca n’empêche que j’ai été au moins quinze jours sans pouvoir dormir, et que j’en avais parlé à un gendarme qui était venu changer le fascicule de Monsieur Clausse, où j’habite, et à un capitaine retraité.
Tous les jours, je lui en parlais en lisant les journaux, en regardant ceux que l’on arrêtait à ce moment-là. Jamais je n’aurais pu garder plus longtemps ce que j’avais vu. Recevez , Madame, mes sincères respects à ce sujet. J’ai vu et trop bien ce pauvre qui voulait échapper à la mort. »
Son témoignage fut corroboré par celui de trois industriels, Messieurs Lécrivain, Fagot et Themelle, qui surprirent à 19h15 trois voitures vides au même endroit, tous feux éteints. Le rapport Guillaume reprocha à Madame Marin sa déclaration tardive, le 25 avril 1934, pour l’écarter.
On sait aussi que le rapport conclut que Prince avait respiré une substance anesthésiante avant son décès. Or, un fait ne fut pas exploré jusqu’à son terme : la découverte, Chemin des Corviottes le 25 février 1934, par un dijonnais, Monsieur Piot, et sa petite fille, d’un bristol portant le nom de « docteur Sanlier-Lamarck des Laboratoires Cortial ». Cet homme fut recherché et déposa.
Il s’avéra qu’il était dans le train du conseiller Prince. Mais fit des dépositions différentes sur ses allées et venues à l’Hôtel de la Cloche lors de deux convocations, l’une devant le commissaire Ogier le 5 mars 1934, l’autre devant le juge d’instruction Rabut, le 24 septembre 1934. Pourtant, le rapport Guillaume le déclara au-dessus de tout soupçon par ses relations professionnelles, sa conduite pendant la guerre et ses titres.
Mais sur ce point, l’auteur Détrez et le journal « L’Oeuvre » du 17 septembre 1934 démontrèrent qu’il n’avait jamais été admis au titre de la médecine légale, ayant exercé en Espagne, et qu’il avait changé son nom avant la guerre. Le veilleur de nuit de l’hôtel situa avec certitude son retour à l’hôtel le 20 février 1934 jour du crime entre 22 heures et 22 heures trente cependant que le faux médecin déclara 18h30.
En outre, selon les parties civiles représentées par Maîtres Poignard et Garçon dans un rapport publié le 25 octobre 1934 par la commission d’enquête de l’affaire Stavisky, un autre témoignage fut écarté par le rapport Guillaume, celui de la concierge de la maison où résidait la mère du conseiller Prince, Madame Beaupoil, qui reçut la visite au mois de janvier d’un homme lui demandant des nouvelles de Madame Prince et le nom du médecin qui la soignait.
Or, celle-ci avait répondu : « je crois que c’est le docteur Ehringer qui est venu quelques fois la voir ». Le commissaire Guillaume ne retint pas son témoignage au motif qu’elle s ‘était montrée incapable de décrire l’individu en question alors qu’elle avait répondu différemment (mais comment ?) aux policiers et journalistes auparavant.
Enfin, le rapport Guillaume reprit des constatations de la brigade mobile sur les lieux du drame à propos de la serviette de Prince trouvée prés de la voie ferrée : « à l’intérieur de la serviette, une lettre décachetée avec en-tête : « Cour de Cassation, cabinet de M. le Président » mise à la poste Paris, 32, Tribunal de Commerce, à 18 heures, ladite lettre adressée à M.Prince, conseiller à la Cour d’appel, 15 rue de l’Odéon. L’adresse est rayée et porte la mention « inconnu 15 rue de l’Odéon ».
Cette enveloppe contenait la convocation pour le mardi 20 février à 17 heures. » Il s’agit de la convocation du président Lescouvé pour demander à Prince de lui faire son rapport sur son traitement du rapport Cousin accusant Stavisky.
Le procureur de la République de Dijon, Monsieur Barra, écrivit au procureur général de Dijon le 23 août 1934 : « pages 7 et 124 du rapport, il est fait allusion à une lettre trouvée dans la serviette de Monsieur Prince. La date indiquée et dont on pourrait faire état en vue de fixer les sentiments de Monsieur Prince la veille de sa mort, est erronée. La convocation visée n’était pas pour le mardi 20 février 1934 à 17 heures, mais bien pour le 23 janvier 1934. »
Cette convocation avait été adressée par erreur à un autre magistrat. C’était celle qu’Albert Prince avait reçue pour déposer sur le troisième rapport de l’inspecteur Cousin accablant pour Stavisky, ce qu’il avait fait le 27 janvier, entraînant le départ forcé de Pressard du Parquet de la Seine le 3 février 1934…
En conclusion, même s’il n’existe pas de preuve formelle de l’assassinat, la thèse du conseiller Prince fuyant ses responsabilités pour le suicide se retrouve fortement diminuée par la mise à l’écart de certains éléments.
Et pourtant, l’attitude du magistrat appelé à rendre son rapport, la possibilité qu’il avait de communiquer avec l’opinion publique pour faire éclater les éléments à charge et se mettre ainsi hors de danger, l’absence de commencement de rédaction de la note, l’affaire troublante du départ précipité pour Dijon sans informer sa hiérarchie, le fait qu’il lui suffisait de passer un coup de fil à Dijon pour s’assurer de l’état de santé de sa belle-mère avant de prendre le train - ce qui anéantissait toute organisation d’un meurtre -, laissent planer un doute sérieux sur l’existence d’un complot.
Quant à l’affaire de Croissy, elle vient s’égarer dans le dossier, semble-t-il, hors de toute manipulation. On pourrait bien sûr se demander si Monsieur Watson ne fit que rapporter ce qu’il avait entendu, pensant accomplir son devoir dans un scandale qui épouvantait l’opinion. Rien ne laisse supposer le contraire, d’autant que l’état psychique de Bruneau pouvait parfaitement s’accommoder de la thèse du crime politique conclue par Bonny en mars 1934.
La France entière, qui se passionna et eut connaissance de la piste criminelle de l’avenue Gounod, reçut avec douleur le verdict du suicide entériné par le dernier rapport Guillaume. Malgré tout, la thèse du crime n’est pas morte. Elle prospère sur le climat insurrectionnel qui sévissait à l’époque et n’aurait pas manqué de redoubler si le conseiller avait procédé à des révélations. On en restera donc au stade des présomptions par défaut de preuves matérielles allant dans le sens de l’assassinat.
Il est d’ailleurs à craindre que l’ouverture du dossier judiciaire Prince en 2034 n’apporte rien de plus au rapport Guillaume. La mort de tous les acteurs de l’époque, l’absence de révélation depuis la fin de cette affaire, ont semé à jamais un doute insupportable sur la tombe du conseiller Prince. Le déclin du pays puis la guerre ont relégué dans les écuries de l’histoire le sang du magistrat du train de la Combe-Aux-Fées.
Soixante-seize ans plus tard, le rappel d’une piste dans la Boucle vient rappeler qu’à Chatou Notre Ville, nous n’avons pas la culture de l’oubli…
Sources :
- « L’affaire Prince – Le secret du crime », Alfred Détrez, Librairie Paillard, 1934
- « Georges Mandel ou la passion de la République », Bertrand Favreau, éditions Fayard (1996)
- « Alain Decaux raconte », Alain Decaux, Librairie Académique Perrin (1978)
- « L’Action française » n°106 – 16 avril 1934, collection privée
- « L’Ouest-Eclair », « Le Matin », « La Croix », des 17 et 18 avril 1934, Archives Municipales de Croissy
- « L’Humanité », des 16, 17, 18 et 19 avril 1934, Archives Municipales de Croissy
- « Police Magazine » n°199 – 16 septembre 1934, collection privée
- « Détective » du 30 août 1934, collection privée
- cadastre de Croissy – recherche de Norbert Fratacci
Publié dans CHATOU ET L'ENTRE-DEUX-GUERRES, CHATOU SOUS LA IIIEME REPUBLIQUE | 14:51 | Commentaires (1) | Lien permanent









Commentaires
Monsieur, quelle culture vous avez et que vous mettez à notre disposition c'est formidable et merci.
Écrit par : Dubois | 18/12/2010
Les commentaires sont fermés.