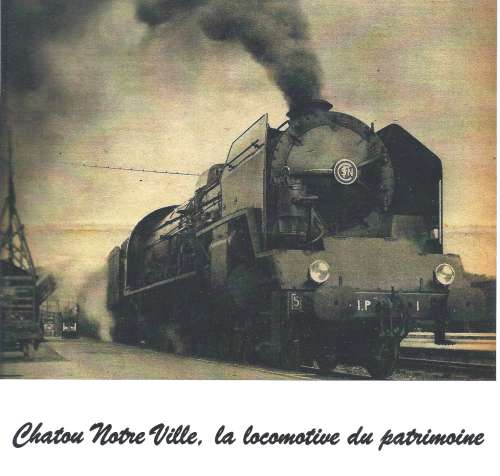17/01/2014
HENRY-LEONARD DE BERTIN, MINISTRE ECLAIRE ET DERNIER SEIGNEUR DE CHATOU (1762-1789) ET SON VOISIN CHANORIER

Gravure de Bertin, par Roslin, Institut de France, Tous droits réservés , don du comte et de la comtesse de Lambertye – décembre 1937 - le dernier seigneur de Chatou fut ministre de Louis XV et de Louis XVI
Henry Léonard Jean-Baptiste Bertin, né en 1720 à Périgueux, traversa la fin de l’Ancien Régime en accumulant une vaste expérience d’administrateur. Intendant du Roussillon en 1750, de Lyon en 1754, lieutenant général de police de Paris en 1757 puis contrôleur général des Finances de 1759 à 1763, ministre des Affaires Etrangères un mois par intérim en 1774, et Secrétaire d’Etat titulaire d’un département hétéroclite à sa demande de 1763 à 1780 (Agriculture, Mines, Poste, Manufactures, Compagnie des Indes...), le dernier seigneur de Chatou et de Montesson (1762-1789) passait pour un homme discret, passionné et désintéressé.
L’un des historiens qui, en 1948, a analysé son œuvre de Secrétaire d’Etat, Michel Antoine, lui dénie la stature d’homme d’Etat, au motif qu’il n’a pas réussi à imposer ses vues et étendre son administration, ne disposant d’aucun soutien dans le cercle des intendants.
Cet homme que l’on range dans les « seconds rôles » sut pourtant se distinguer dans ses nombreuses attributions. Il est d’ailleurs impossible ici de reprendre toutes ses initiatives.
 C’est le premier conseiller de Louis XV, Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, secrétaire du roi, le « ministre de l’Intérieur » de l’époque (ci-contre), qui amena Bertin au Contrôle des Finances en 1759.
C’est le premier conseiller de Louis XV, Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, secrétaire du roi, le « ministre de l’Intérieur » de l’époque (ci-contre), qui amena Bertin au Contrôle des Finances en 1759.
Ce dernier était alors Lieutenant de Police de Paris et dans la faveur de Madame de Pompadour, qu’il avait protégée. Si Bertin accepta le poste de Contrôleur Général des Finances (1759-1763), ce fut à son corps défendant. Et la cour, assise sur la bombe à retardement d’une gestion calamiteuse des deniers publics et de l’impôt, eut à s’accommoder d’un homme plus résolu qu’elle ne l’avait crû.
Dans ses « Particularités et observations sur le ministère des Finances » (1812), Monsieur de Monthion, ancien conseiller d’Etat de Louis XVI et agronome de la génération Bertin, rapporta ce mot de Madame de Pompadour au sujet du ministre : « C’est un petit homme qu’il est impossible de maîtriser. Lorsqu’on le contrarie, il n’a qu’un mot sur les lèvres : « cela ne vous convient pas, je m’en vais ».
Contre toute attente, et après l’échec de ses prédécesseurs, le seigneur de Chatou restaura la confiance et finança la guerre de 7 ans au prix d’emprunts et d’une fiscalité écrasante. Désireux d’assainir la situation du pays, il présenta la guerre finie différents projets d’impôts avec un projet de cadastre en avril 1763.
La fronde des Parlements fut la réponse, entraînant le renvoi du ministre pour éviter une crise politique majeure. Bertin et Louis XV durent s’en souvenir lorsqu’ils engagèrent la réforme du chancelier Maupeou (gravure ci-dessous) en 1770, exilant les Parlements et tentant la dictature royale.

De même, lorsque Louis XVI voulut rappeler les Parlements en 1774, Bertin ministre fit partie du pré-carré avec le comte de Provence et le comte de Vergennes qui s’opposa vainement à leur retour.
Sacrifié et honni, Maupéou quitta la cour à Compiègne le 24 août 1774 dans une déclaration fameuse au comte de Saint-Florentin : « j’avais fait gagner au roi un procès qui durait depuis trois cents ans. Il veut le reperdre, il en est le maître. Voici les sceaux ».
Puis, levant les yeux vers l’appartement royal sur le perron, le pied sur le montoir de la voiture, il eut ce mot moins noble mais tout aussi exact : « il est foutu ».
L’exil du chancelier passa vraisemblablement par Chatou si l’on en juge la chanson qui immortalisa son départ : « Sur la route de Chatou, en foule on s’achemine pour voir la triste mine du chancelier Maupéou sur la rou…sur la rou…sur la route de Chatou. »
Si Chatou accueillit les derniers tenants de l’antiparlementarisme, la France aux Parlements restaurés accomplit les prédictions du cercle Maupéou. Les ministres réformateurs de Louis XVI, Turgot, Malesherbes, Saint-Germain, devinrent la cible de violentes campagnes qui finirent par les emporter dés 1776.
Pour leur succéder, le roi retourna pendant treize ans à la politique des expédients, jusqu’à ce que la Révolution fasse litière de tout l’édifice.
En toile de fond de cette trame historique bien connue, une entreprise plus sourde et tout aussi importante se doit d’être évoquée, celle qui cristallise le lien entre Bertin et Chanorier, son voisin de Croissy à partir de 1779. Il s’agit du domaine de l’agriculture et des sciences.
Si Colbert avait été l’artisan de la renaissance du commerce en France, Bertin, voyant le pays s’effondrer sous le poids des guerres et des injustices, rattacha l’agriculture au Contrôle Général des Finances et tenta d’être le rénovateur de l’agriculture française.
La tâche était à la hauteur de l’enjeu : au XVIIIème siècle, 20 millions de Français cultivaient 35 millions d’hectares sur les 51 millions que comptaient le pays. Le cultivateur, après avoir livré ses denrées dont le prix de vente était fixé à bas prix à dessein par le gouvernement, se retrouvait dans une misère complète lors des fréquentes disettes.
Cette situation attira l’attention d’un certain nombre d’économistes, parmi les plus connus Gournay et Quesnay, qui préconisèrent l’instauration de la liberté commerciale pour sortir de la pénurie. Contrôleur Général des Finances, Bertin participa à ce courant « physiocratique » par divers moyens.
Bertin Contrôleur Général des Finances nomme Turgot
Il le fit en nommant en août 1761 Turgot intendant du Limousin, dans la région la plus pauvre de France, dont celui-ci garda l’administration pendant treize ans. De fait, Bertin imposa « l’expérience Turgot » dans notre histoire nationale.
L’idée principale du nouvel intendant était que la richesse de la Nation résidait dans son agriculture et que son développement devait être la priorité du régime. Dans une province où 40% du revenu des terres étaient prélevés par le roi, Turgot obtint par le harcèlement de l’administration royale le dégrèvement de 600.000 livres par tranches annuelles de 200.000.
 Jetant à bas tout confort de vie et commencement de mondanité, il fut l’homme lige du système physiocratique. La délégation lui faisant horreur, il fut lui-même l’ingénieur des 160 lieues de routes qu’il fit construire ou reconstruire.
Jetant à bas tout confort de vie et commencement de mondanité, il fut l’homme lige du système physiocratique. La délégation lui faisant horreur, il fut lui-même l’ingénieur des 160 lieues de routes qu’il fit construire ou reconstruire.
Il établit un plan d’urbanisme de Limoges, y fit construire un palais de justice, un évêché et un collège et fut à l’origine de la naissance de l’industrie de la porcelaine. A la répartition arbitraire et sans contrôle de l’impôt, il voulut répondre par l’établissement d’un cadastre, projet qu’il ne put cependant terminer.
Dans chaque paroisse, des « collecteurs » élus par la population à la sortie de la messe du premier dimanche d’octobre étaient chargés de dresser les rôles et de percevoir l’impôt. Les contribuables ne payant pas, le roi envoyait ces « élus malgré eux » croupir en prison pendant dix mois, parfois par centaines au sein de la généralité. Turgot supprima ce système et le remplaça par des fonctionnaires chargés du même travail mais payés par la commune.
En 1764, il publia « le plan d’un mémoire sur les impositions en général, sur l’imposition territoriale et sur le projet de cadastre », dans lequel il afficha sa préférence sur l’impôt sur le revenu mais en l’abandonnant aussitôt au motif que le contribuable se réfugierait perpétuellement dans la fraude. Seul l’impôt de répartition fondé sur la propriété foncière avait selon lui un avenir.
L’essor de cet impôt à partir de la Révolution ne démentit point son analyse. Enfin, si l’intendant résorbait en partie le problème fiscal, restait la corvée, réquisition sans indemnité des paysans pour l’entretien des routes et des chemins.
Turgot la supprima dans sa généralité en donnant aux communes la charge de l’entretien au prorata de leur importance. Autre désespoir des foyers, une milice communale était tirée au sort, les hommes étant employés sans solde ni indemnité.
Les régions étaient traversées par les fuyards, les régiments de ligne ne se gênant pas pour procéder à des incorporations arbitraires. Ceux qui remplaçaient les élus disparus étaient envoyés les chercher et bien souvent des bagarres ou des meurtres concluaient l’affaire. Turgot imposa tous les mobilisables d’une somme modique pour payer des volontaires et le problème fut réglé.
Enfin, au titre des servitudes abhorrées, l’habitant devait loger la garnison. Turgot fit construire une caserne à Limoges pour y confiner les troupes. Il abrogea dans la foulée les réquisitions chez les particuliers pour les transports militaires en passant commande auprès d’entrepreneurs par un impôt additionnel à la taille.
Lorsque la disette s’installa dans le Limousin et partout ailleurs pendant deux ans en 1770, Turgot vit, malgré ses ordres, la liberté des grains bafouée par les arrêts des Parlements, de sorte que les propriétaires ne voulaient plus sortir leur récolte de peur qu’elle soit réquisitionnée à bas prix.
L’intendant abolit alors la taxe sur le pain, supprima le privilège des boulangers urbains et fit ravitailler les villes par les communes rurales. Il interdit aux propriétaires de renvoyer leurs employés ou les obligea à nourrir quatre indigents pour chaque renvoi et enfin créa des ateliers de charité. En vain.
Bertin, qui parallèlement avait convaincu Louis XV de rendre un édit autorisant la libre circulation des grains et des farines dans tout le royaume le 25 mai 1763, vit sa politique subir le même sort que celle de Turgot. La liberté de circulation fut abrogée le 23 décembre 1770 par le Contrôleur des Finances en place depuis le 18 février, l’abbé Terray.
Mais à la faveur du changement de règne en 1774, Turgot prit à son tour le Contrôle Général des Finances. Il présenta au Conseil du roi un projet d’édit le 13 septembre 1774 rétablissant la liberté de circulation des grains mais en la limitant à l’intérieur du pays et en excluant cette fois-ci l’exportation.
Cette prudence fut jugée insuffisante, y compris par son ami et secrétaire d’Etat Bertin qui le mit en garde immédiatement : « Je vous exhorte à mettre dans votre marche toute la lenteur de la prudence. J’irai jusqu’à vous inviter, si cela vous était possible comme à moi, et si vous n’aviez pas depuis longtemps pris couleur, à masquer vos vues et votre opinion vis-à-vis de l’enfant que vous avez à gouverner et à guérir. Vous ne pouvez vous empêcher de jouer le rôle du dentiste ? soit, mais autant que vous le pouvez, ayez l’air, sinon de tourner le dos à votre but, du moins d’y marcher à pas très lents. » Malgré tout, l’édit fut adopté le 20 septembre 1774 et traversa même « la guerre des farines » qui éclata à la suite de la disette en avril-mai 1775.
Comme en 1770, on dut se rendre au constat qu’en dépit de la liberté instaurée, les moyens structurels d’une augmentation de la production agricole faisaient défaut.
Dénué de tout sens politique et incapable de communiquer, Turgot répéta son expérience limousine en faisant enregistrer par lit de justice du roi le 12 mars 1776 la suppression : des corvées, de la police des grains à Paris, des offices sur les quais, les halles et ports à Paris, des jurandes et des maîtrises, de la caisse de Poissy et la modification des droits sur les suifs.
Avec ces réformes, l’impopularité de Turgot toucha son apothéose auprès des puissants. Malgré le scandale, le contrôleur général crut bon d’ajouter encore un projet : la création d’ « une grande municipalité du royaume », qui remplacerait avantageusement les Parlements, jugés non représentatifs par le ministre.
Cette révolution que Turgot offrait avec assurance à la monarchie était longuement développée dans un « Mémoire sur les municipalités ». C’en fut trop pour l’esprit timoré et passablement agressé du roi qui se vit à la tête d’Etats Généraux perpétuels. Les campagnes menées par la cour et les Parlements triomphèrent alors dans la disgrâce du ministre, disgrâce que Bertin fut chargé de lui annoncer au matin du 12 mai 1776.
La création de sociétés d’agriculture
Si Bertin initia l’expérience Turgot sans en partager le caractère entier pour des raisons politiques évidentes, il s’enquit aussi de promouvoir l’amélioration scientifique de la culture, en créant des sociétés d’agriculture dans tout le pays.
Le Contrôleur Général développa ainsi une initiative de l’Assemblée des Etats de Bretagne, laquelle s’était dotée le 2 février 1757 d’une société d’agriculture. Il adressa le 22 août 1760 une circulaire à tous les intendants de province en leur demandant de procéder à la création de telles sociétés.
Entre l’arrêt du Conseil du Roi du 24 février 1761 créant la société royale d’agriculture de Tours et celui du 4 septembre 1763 créant la société du Hainaut, 15 sociétés pourvues d’un bureau général et de bureaux secondaires essaimant sur l’ensemble du territoire furent créées.
Toutes les notabilités furent réquisitionnées pour participer à ce mouvement, parfois avec difficulté. Très rapidement, l’œuvre des sociétés d’agriculture dépassa leur objet.
Enfermées par Bertin dans un aspect pratique lors de leur création, elles devinrent finalement l’interlocuteur du gouvernement sur des propositions de réforme de la fiscalité locale. Bertin y eut sa part puisqu’il demanda notamment aux sociétés leur avis sur l’exemption des dîmes en faveur des terres défrichées et sur la limitation du droit de parcours.
Dans un discours de 1788 aux membres du bureau de la société royale d’agriculture de Laon dont il était directeur, Cambronne résuma ainsi la situation : la société n’avait pas seulement pour mission de « tenir la charrue », « elle devait aussi ôter la pierre qui empêchait la roue de tourner ». C’est ainsi que les sociétés s’attaquèrent à toutes les entraves, en particulier l’instabilité des baux, au nom de laquelle elles s’aliénèrent les propriétaires.
Elles dénoncèrent notamment les baux ecclésiastiques qui tombaient à la mort du bailleur, entraînant l’éviction du laboureur qui y était lié. Charpentier, de la société d’agriculture de Soissons, écrivit en 1762 au gouvernement pour lui demander de fixer la durée des baux à 9 ans.
En outre, les sociétés dénoncèrent le « rançonnement » du paysan qui devait payer un prix très élevé pour continuer à bénéficier des baux alors qu’il s’acquittait déjà d’une multiplicité d’impôts : l’abbé Terray, qui hérita du Contrôle Général des Finances en 1770, reconnaissait que « tout bail porte un pot de vin en argent, payable ordinairement dans l’année du renouvellement du bail. »
La tacite reconduction des baux fut également mise en cause par les sociétés car le propriétaire, souhaitant évincer le fermier au moment des bonnes récoltes qu’il lui confisquait, avait intérêt à préférer une tacite reconduction à un nouveau bail fixant une durée dont il restait tributaire.
Bertin, qui connaissait cette pratique à trois reprises condamnées par des arrêts de Louis XIV, du Régent et de Louis XV, fit prendre au roi une déclaration le 20 juillet 1764 dans laquelle celui-ci interdisait la tacite reconduction sous peine de sanctions les plus sévères.
Le remplacement de tous les impôts par un impôt unique fut également plébiscité, la société d’Orléans notamment écrivant le 10 mars 1768 que cela « assurerait à jamais la stabilité et la richesse, soulagerait en même temps les sujets et tarirait efficacement la source de cette spoliation rapide qui trahit les intentions du souverain le plus chéri et ruine rapidement ses peuples. »
Dans l’un de ses mémoires, Monsieur Saint Péravy, de cette société, détermina, à partir d’un savant calcul différenciant les cultures, la part que les producteurs, les propriétaires, le souverain, les ministres du Culte devaient avoir dans le produit de la terre. Au total, le fermage, les impôts et la dîme additionnés ne devraient jamais excéder un tiers de la production selon lui.
La paille, sujette à la dîme, servait d’engrais et son prix trop élevé la réservait à un petit nombre de fermiers, assurant la médiocrité des récoltes. La fixation du prix de la paille fut réclamée mais là encore, le privilège de quelques-uns l’emporta.
Enfin, la corvée fut condamnée à l’unanimité. Elle était considérée comme « un grand effort pour un mince effet et une surcharge purement gratuite », s’exécutant de surcroît à l’époque des grands travaux agricoles. Son remplacement par un financement par l’impôt fut préféré par les sociétés au système anglais de paiement de l’entretien par un droit de péage.
Une fois de plus, rien n’aboutit. Péravy avait déjà énoncé les termes du problème le 16 septembre 1762 : « jusqu’à présent, les lois sont pour les maîtres, à peine en est-il une pour le laboureur. Les lois devraient prendre au moins en considération ceux qui par leur travail donnent la vie à tout le corps et il y aurait ample matière à un code rural. »
A partir de 1764 , le gouvernement exempta des impositions diverses pour une durée de cinq, dix voire vingt ans, tous ceux qui entreprendraient les dessèchements des marais, palus et terres inondées.
Après s’être assurée de l’avis favorable de presque toutes les sociétés d’agriculture, la société de Paris demanda, sans suite, l’extension de l’exemption au défrichement des landes.
L’outillage agricole fut à l’honneur dans les études des sociétés : charrues, semoirs, batteuses, furent des sujets fréquents d’inventions de perfectionnements.
Quant à l’alimentation, on sait quelle révolution se popularisa sous le règne de Louis XVI grâce aux sociétés d’agriculture : en 1771, la société d’agriculture de Besançon proposa en sujet de prix les « substances alimentaires qui pourraient atténuer les calamités d’une disette ». Parmentier y répondit par un mémoire fort célèbre dans lequel il exposa : « la pomme de terre doit être, parmi nous, le puissant auxiliaire du blé. Trop longtemps dédaignée, trop longtemps exclusivement réservée à la pâture des bestiaux, il faut que la pomme de terre devienne aussi la nourriture de l’homme, il faut, en un mot, qu’elle apparaisse sur la table du riche comme sur celle du pauvre et qu’elle y occupe le rang que sa saveur, ses qualités nutritives et la sanité de sa nature devraient lui avoir acquis depuis longtemps. »
La société renvoya le mémoire à Bertin qui le fit imprimer et diffuser en 1778, au prix de querelles scientifiques animées. Louis XVI ordonna alors la mise à disposition de 54 arpents de terre dans la plaine des Sablons et, avec le concours de la Société d’Agriculture de Paris dont Parmentier était membre, ce dernier réussit la culture du légume dont le produit fut distribué aux pauvres.
La pomme de terre, dont le roi n’hésita pas à porter les fleurs qui lui furent données par Parmentier les fêtes de la Saint-Louis, s’imposa dans les années 1785-1789.
Bien que la composition des sociétés d’agriculture mêla des personnages de haut rang, le résultat de leur activité fut considéré comme mitigé.
Il est cependant loin d’être insignifiant : sur le plan fiscal, exemption des impositions sur les terrains défrichés, affranchissement du droit de centième denier sur les baux à long terme, sur le plan agricole, développement de la culture du navet, de la pomme de terre, des prairies artificielles, de la betterave fourragère, de la garance, du mûrier, de la chanvre, introduction originale de la culture du riz en Touraine, en Charente et dans le Limousin.
Sur un plan purement théorique, les sociétés abordèrent tous les sujets avec une liberté de ton qui s’accordait à leurs convictions. En fin de compte, on leur doit d’avoir véhiculé les idées qui amenèrent l’émancipation du travail sous la Révolution. Certes, le pont-levis rêvé entre les sociétés savantes et le monde rural ne fut pas établi.
Mais le succès était-il vraiment à attendre, dans un contexte au sujet duquel Lamoignon de Malesherbes, lui aussi ministre agronome, écrivit : « le peuple, surtout celui des campagnes, était en garde contre tout ce qu’on lui proposait, même pour son avantage, parce que le cultivateur se croyait obligé de cacher les ressources de son industrie, par la crainte que son aveu ne fit augmenter sa cote d’imposition. »
Une révolution manquait : les paysans demeuraient soumis au paiement de la taille, de la gabelle, des aides, des vingtièmes, de la capitation, de la corvée royale, des douanes et des traites pour circuler, de la dîme, des droits seigneuriaux et des rentes seigneuriales. Leur condition était d’ailleurs parfois soutenue par une arriération sans appel : telle la minorité de serfs, évaluée à 150.000 sujets en 1760, les « mainmortables ».
Il faut enfin ajouter que l’ennemi de Bertin, de Turgot et de la réforme Maupéou, Necker, au pouvoir central des Finances de 1776 à 1781, s’évertua à réduire les moyens d’action du secrétariat d’Etat de Bertin et à en dénigrer l’action, au point que son titulaire préféra abandonner le pouvoir le 26 mai 1780, laissant dissoudre son secrétariat d’Etat.
Réduites à l’indigence et ignorées, plusieurs sociétés qu’il avait créées avaient soit disparu soit ne fonctionnaient plus faute d’hommes et de moyens.
L’une des « rescapées », la Société d’Agriculture de la Généralité de Paris, fondée par arrêt du conseil du roi du 1er mars 1761, est néanmoins entrée dans la postérité puisque qu’elle est devenue, après plusieurs dénominations selon les régimes, l’Académie d’Agriculture de France en 1915, société dont les membres demeurent nommés par décret du président de la République.
Bertin en resta membre pendant 30 ans, jusqu’en 1791, et son ami Chanorier en devint correspondant à partir de 1799. La société attribua d’ailleurs cette même année un prix à l’un des bergers du seigneur de Croissy, le citoyen Grellée.
Bertin avait créé une école de boulangerie à Paris en 1777 à la tête de laquelle il avait mis Parmentier. Celle-ci fut réunie en février 1789 à la société royale d’agriculture, successeur de la société d’agriculture de Paris.
Le 30 mars 1786, en la présence solennelle du Contrôleur Général Calonne, le duc de Béthune-Charost, directeur de la Société d’Agriculture de Paris, rendit hommage à Bertin, le fondateur, « un ministre dont toutes les opérations avaient pour but l’utilité publique ».
La création des écoles vétérinaires
Loin de s’arrêter à la propagation des sociétés d’agriculture, Bertin résolut de s’attaquer aux maladies des bestiaux, les « épizooties ». Intendant de Lyon de 1754 à 1757, il avait rencontré Claude Bourgelat, ancien avocat au Parlement de Grenoble, devenu écuyer de l’Académie d’Equitation de Lyon. Auteur en 1750 d’un ouvrage « Elemens d’hippiatrique » dans lequel il proposait la création d’écoles pour soigner les chevaux, Bourgelat était devenu correspondant de l’Académie des Sciences en 1752.
Bertin Contrôleur des Finances convainquit en juillet 1761 La Michodière, son successeur à l’intendance de Lyon, du bien-fondé du projet de Bourgelat. Puis, armé de l’avis favorable de l’intendant, il obtint de Louis XV un arrêt du Conseil du 4 août 1761 autorisant l’ouverture d’une école à Lyon. Celle-ci reçut ses premiers élèves en février 1762 et se vit octroyer à la demande de Bertin le titre d’Ecole Royale Vétérinaire le 3 juin 1764 après que ses élèves aient arrêté une épidémie à Meyrieux en juillet 1762. L’école de Lyon fut la première école vétérinaire dans le monde.
Bourgelat souhaitait qu’elle soit transférée à Paris mais Bertin, à la tête de son nouveau département d’Etat depuis le 14 décembre 1763, lui répondit qu’il préférait en créer une seconde dans la capitale. Ce fut finalement le château de Maisons-Alfort, vendu par le baron de Bormes à Louis XV, qui accueillit cette nouvelle école le 27 décembre 1765.
Son ouverture ne fut pas considérée comme un bienfait par les habitants, mais plutôt comme une provocation, ce dont attesta un rapport de police :
« le 2 août 1766, à cinq heures et demi du soir, Legros, concierge du château d’Alfort (…) se porta avec des aides dans un terrain dépendant du château sur le bord de la Marne, au-delà du chemin de Créteil, à l’effet de faire amener au château l’avoine qu’on y avait coupée. Il trouva nombre de particuliers qui chargeaient cette avoine avec des ânes. Il eut beau crier, la multitude l’accabla d’injures, et les plus forts emportèrent l’avoine qu’ils avaient chargée. Legros les suivit jusqu’auprès du moulin, prés du Château Gaillard, il y entra. Sept ou huit meuniers en sortirent avec pelles, fourches et l’auraient tué, s’il n’avait pris la fuite. Il ajoute que la populace insulte tous les jours les gens qui travaillent à Alfort ;(..). »
Berthier de Sauvigny, intendant de Paris, fut mandé par Bertin pour rétablir l’ordre.
Pour financer les écoles vétérinaires, Bertin s’arrangea pour que les concessionnaires des postes et des transports publics leur versent une part de leurs bénéfices. Il leur fit également profiter de revenus de la principauté de Dombes, qu’il avait dans son ministère.
Les fondateurs des écoles vétérinaires de l’Europe entière vinrent puiser à Lyon et Alfort les enseignements qui leur permirent d’ouvrir à leur tour de semblables établissements dans leur pays.
Joseph II, empereur du saint-empire romain germanique, roi de Hongrie et de Bohême, honora de sa présence l’école en 1777 alors qu’il rendait visite à sa sœur Marie-Antoinette. Il posa, selon les témoignages, d’innombrables questions.
Après la mort de Bourgelat en 1779, Bertin voulut élargir le champ d’action des écoles vétérinaires aux soins des paysans eux-mêmes. C’est ainsi qu’il obtint par ordonnance royale du 7 mars 1780 la création de deux cours, l’un « d’accouchement » et l’autre dit « de reboutage ».
Il envisagea la création de cours sur les maladies des yeux, le moyen de rappeler les noyés à la vie, les signes de la mort afin d’éviter les inhumations en état de mort apparente. Mais Necker était bien décidé à se débarrasser de lui et il dut se retirer en mai 1780.
Les écoles vétérinaires contribuèrent à d’importants progrès scientifiques auxquels participèrent Pasteur et bien d’autres. Notons qu’après la fermeture en 1781 (prononcée avec le départ de Bertin) de l’école d’Annel, prés de Compiègne, ouverte par Bertin en 1771, il ne restait plus d’école d’enseignement de l’agriculture.
Mais l’école vétérinaire d’Alfort qu’il avait fondée eut l’idée en 1783, grâce à l’intendant de Paris devenu également intendant des Ecoles vétérinaires, Berthier de Sauvigny, de créer plusieurs chaires d’enseignement : une chaire d’anatomie comparée, une chaire d’histoire naturelle et d’agriculture, une chaire de physiologie, de chimie et de physique et une chaire d’économie rurale, tenue par Daubenton.
Berthier de Sauvigny, malgré son œuvre, fit partie des victimes de la Révolution : le 22 juillet 1789, des manifestants l’arrachèrent aux Gardes-Françaises chargées de le protéger et le massacrèrent.
Le succès des écoles vétérinaires fut néanmoins certain jusqu’aux derniers jours de l’Ancien Régime. « L’Almanach vétérinaire » écrit par Chabert en 1782 établit un bilan des missions très éloquent.
A une époque où l’on balbutiait sur les diagnostics et encore plus sur les remèdes, le sauvetage fut bien souvent le fait de précautions sanitaires prises par les élèves envoyés sur les lieux de l’épizootie et d’une lutte contre les superstitions. C’est ainsi qu’entre 1762 et 1780, 820 animaux moururent pendant le traitement, 16.999 furent traités et guéris, 36.573 soumis à un traitement dit « préservatif ».
Bertin assista aux concours organisés par l’école d’Alfort et interrogea lui-même des élèves. Avec Bourgelat, directeur des écoles, il entretint une correspondance très suivie, sans aucun intermédiaire, le ministre faisant une affaire personnelle de la réussite de « l’art vétérinaire » naissant.
Chatou-Croissy : un voisinage de physiocrates
Malgré la différence de génération entre les deux hommes, on ne saurait trop rappeler les similitudes entre Bertin (1720-1792) et Chanorier (1746-1806). Ce dernier avait des oncles à Bourdeilles dans le Périgord, dont Bertin était le baron et seigneur.
En outre, son père avait été anobli et lui avait transmis sa charge de receveur général des Finances qu’il exerçait à Lyon lorsque Bertin y accomplit son mandat d’intendant entre 1754 et 1757. Les deux familles se connaissaient donc déjà et sans doute se fréquentaient. Si Chanorier vint à Croissy en 1779, tout laisse à penser que Bertin n’y fut pas étranger.
Le goût de l’agronomie scella ce rapprochement dans notre « région du pot-au-feu » selon le mot d’Henri IV. Les propriétés des seigneurs de Chatou et Croissy furent en effet transformées respectivement, en 1762 pour l’une, et en 1779 pour l’autre, en de vastes champs d’expérimentation de l’élevage et de la culture. Rien ne fut négligé.
De la pomme de terre, la « chanorière » de Chanorier, aux mûriers pour l’élevage des vers à soie, aux cerises, les « marseneix » et « royales » de Bertin, sans compter les cultures maraîchères si réputées de Croissy et Montesson, les cultures des deux seigneurs firent leur réputation peut être plus encore que leur vie publique.
Selon une lettre du 5 avril 1771 de l’une des sœurs du ministre, Mademoiselle de Bellisle, rapportée par l’historien Albert Curmer, la pomme de terre était déjà cultivée par Bertin avec succès, quand Parmentier vint en présenter pour la première fois les bienfaits à la société d’agriculture de Besançon la même année. Bertin s’était fait également connaître de Louis XV pour posséder une armée de cuisiniers hors pair.
Enfin les deux hommes conduisirent une expérience d’élevage de moutons d’Espagne de la race Mérinos.
Si Bertin se sépara de son troupeau en quittant Chatou à la fin de 1791, Chanorier bénéficia pour sauver le sien de la Révolution des grandes voix du nouveau « bureau consultatif d’agriculture », celles de messieurs Cels, Gilbert, Vilmorin, Huzard, de Labergerie et Parmentier, qui obtinrent d’en faire un établissement rural national à l’instar de Rambouillet, selon le témoignage de l’académicien Tessier dans son « histoire de l’introduction et de la propagation des mérinos en France ».
Chanorier sortit par chance indemne du génocide révolutionnaire. Après l’exécution de Robespierre le 9 Thermidor et l’enterrement du régime de la Terreur, il rentra de son court exil en Suisse mais ne retrouva la totalité de ses biens qu’à la suite de deux décrets des 30 mai et 13 août 1796.
Il devint président de la Société Libre d’Agriculture de Seine-et-Oise créée par le gouvernement en 1798. A la tête d’un troupeau composé d’environ 400 animaux de pure race, moutons, béliers, brebis, qu’il augmenta chaque année de 120 sujets nouveau, il reprit la vente régulière d’une partie de son cheptel.
Aussi son domaine devint-il le rendez-vous des amateurs des bêtes de troupeau de race pure. Les « Annales d’agriculture » du Directoire mentionnent l’annonce de l’une des mises en vente de Chanorier, dont on peut lire cet extrait : « si des cultivateurs des départements éloignés désirent des animaux de race pure de l’établissement du citoyen Chanorier, il se chargera de les faire conduire dans les chefs-lieux qui les avoisinent, moyennant la simple augmentation des frais de route, qui seront calculés d’après l’éloignement et convenus avant le départ des animaux demandés. »
Une autre annonce de l’époque du Consulat a été reproduite dans ces mêmes « Annales ». Elle se termine ainsi : « ceux qui désireront que leurs bergers prennent une idée de moyens qui, depuis dix-huit ans, ont été employés avec avantage dans cet établissement, pourront, s’ils le veulent, envoyer leurs bergers une ou deux semaines à l’avance ; le citoyen Chanorier les logera ; ils se nourriront à Croissy, et son berger les instruira de tous les détails qui pourront leur être utiles. »
Mais Chanorier ne fut un bon commerçant que parce qu’il fut avant tout un éleveur éclairé, et à ce sujet, on ne tiendra pas pour ordinaire le fait que l’Académie des Sciences le distingua à plusieurs reprises.
Celle-ci lui décerna en effet le 25 décembre 1797 le statut d’ « élu associé non résidant de la section d’économie rurale et d’art vétérinaire de la première classe de l’Institut ». Ce fut la conséquence d’un rapport élogieux de l’Académie au sujet d’un mémoire de l’intéressé du 22 mai 1797 sur « l’amélioration des bêtes à laine », dont l’élevage était encore peu répandu en France contrairement à l’Espagne, l’Angleterre et la Saxe.
Dans ce mémoire d’une cinquantaine de pages, Chanorier étudie l’histoire, les terres propres aux bêtes à laine, la construction des bergeries, le choix des béliers et le temps de l’accouplement, les agneaux, la nourriture des bêtes à laine, le parcage et les engrais, les maladies des bêtes à laine et leurs remèdes, la tonte et la fabrication des laines.
L‘Académie écrivit : « l’auteur, qui possède le plus beau troupeau de la République après celui de Rambouillet, n’avance rien qu’il n’ait appris d’après sa propre expérience. Il est du très petit nombre de cultivateurs qui portent le calcul dans toutes leurs opérations, il sait que ce qui fait la richesse du cultivateur, c’est moins bien un grand produit, qu’un grand bénéfice, et que l’or lui-même peut être payé trop cher. Nous devons ajouter que le citoyen Chanorier est du nombre bien plus rare encore des cultivateurs qui ont résisté longtemps à la séduction de la jouissance exclusive. Il a longtemps donné la plus grande partie des produits de son troupeau, dont sont sortis les germes de plusieurs troupeaux qui jouissent d’une réputation méritée. »
Le 6 décembre 1798, par 212 voix contre 145 à son concurrent le plus proche, Jean Chanorier fut le mieux élu des six candidats de l’Académie au titre de correspondant de la section d’agriculture.
Le 24 juin 1799, il vint à l’Académie lui présenter sa dernière fabrication, un drap bleu à l’appui d’un rapport. Le jury, composé de Daubenton, Desmarets et Fourcroy, se déclara admiratif du soin qu’avait mis son auteur « pour conserver pendant 14 ans un troupeau (de moutons) de race d’Espagne dans toute sa pureté, qu’il a donné la preuve de ce succès par le drap qu’il a fait fabriquer avec ses toisons, lequel réunit la force à la souplesse qui caractérisent les draps fabriqués avec les laines qui arrivent d’Espagne et des cantons les plus renommés. »
En 1802, Chanorier était atteint par la folie, au désespoir de tous ses proches. Mais l’Académie des Sciences souhaita lui renouveler sa considération. Le 31 janvier 1803, elle l’élit pour la seconde fois membre associé de la section de l’économie rurale et les arts vétérinaires dans la classe des sciences physiques et mathématiques.
Quant à Bertin son aîné, il ne soumit point de travaux à l’Académie des Sciences. Mais en raison de son action tant au Contrôle Général qu’au Secrétariat d’Etat, il fut élu vice-président en 1763 et 1769 et président de l’Académie en 1764 et 1770. Après 1780, il vécut retiré à Chatou.
Son collaborateur au cabinet des Chartes, l’avocat Moreau, évoqua cette situation : « (Louis XV) lui avait voulu donner cent mille écus pour y bâtir un château ; M.Bertin les avait refusés, il vivait là avec sa nombreuse famille et, pour son plaisir, faisait travailler à grands frais le village entier aux jardins anglais qui étaient alors sont goût dominant. J’ai été témoin de ce qu’il dépensait pour nourrir les pauvres ; il ne fit que des ingrats. »
Notons que Bertin vécut également au rythme du contentieux qu’il avait créé un an plus tôt avec les habitants, auxquels il avait interdit la traversée publique de son domaine. S’il conserva des relations avec Vergennes, défavorable comme lui à Necker et aux Parlements, ce fut en vain que Louis XVI lui maintint un appartement à Versailles. « La France a fait son temps, vivez en famille, vous ne reverrez ni la cour de Louis XV ni la cour de Louis XVI. », écrivit Bertin en 1790 à Moreau. Son domaine vendu à la malheureuse Madame de Feuquières (qui prit ainsi rang sans le savoir sur la guillotine), le ministre s’éteignit à Spa le 16 septembre 1792, six jours avant la proclamation de la République.
Son voisin de Croissy épousa lui aussi le courant de l’ordre et des réformes. Jean Chanorier fut élu député du Tiers Etat à l’assemblée provinciale de Saint-Germain réunie en octobre 1788, en s’imposant une démarche singulière qu’il évoqua par la suite : « quoique jouissant des privilèges de la noblesse, j’y représentai ceux qui en étaient privés ; j’eus le bonheur, à cette époque, avant qu’il fût question d’Etats Généraux et de cahiers, d’obtenir du clergé et de la noblesse la renonciation aux privilèges : les procès-verbaux attestent cette vérité. »
Reprenant l’idée initiale de Turgot, il y préconisa l’impôt territorial en remplacement du système existant. Député au conseil des Cinq-Cents le 16 avril 1799 et dans l’entourage de Joséphine de Beauharnais, il fut probablement l’un des membres qui y soutint le coup d’Etat du 18 Brumaire (9 novembre 1799). Il s’éteignit le mai 1806.
Même éparses et isolées de l’opinion publique, les initiatives d’ Henry Léonard de Bertin et de Jean Chanorier eurent le grand mérite de se démarquer des milieux viciés des régimes en place pour tenter d’améliorer la situation déplorable de leurs contemporains. A leurs niveaux respectifs, ils incarnèrent ces « libéraux agronomes », défenseurs d’une économie nouvelle « affranchie » et plus juste pour notre pays. Cela leur donne sans conteste droit à un hommage mérité de nos deux communes.
N.B : cet article a été réalisé par l'auteur pour "La Mémoire de Croissy" en 2006 et publié dans son Bulletin
Sources :
Archives de l’Académie des Sciences, Institut de France
Jean Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, Armand Colin, 1970
C-J. Cignoux, Turgot, Arthème Fayard, 1945
Jacques Catinat, C’est arrivé à Croissy, Association des Amis de la Place d’Aligre et du Vieux Croissy, 1971
Charles Bonnet, Histoire de Croissy, 1894, Réédition Res Universis, 1991
Albert Curmer, Histoire de Chatou, Réédition Res Universis, 1991
Claude Joseph Blondel, « Henri Bertin, ministre de deux rois, rénovateur de l’agriculture française », Revue numéro 2 de l’Académie d’Orléans, Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts – novembre 2002
L’auteur adresse ses plus vifs remerciements à Monsieur Pierre Zert, membre de l’Académie d’Agriculture de France, qui l’a orienté et mis à sa disposition les ouvrages suivants :
Annales d’agriculture Emile Justin, Les sociétés royales d’agriculture au XVIIIème siècle (1757-1793), Saint-Lô, 1935
Louis Passy, Histoire de la société nationale de l’agriculture de France, tome 1, Renouard, 1912
Railliet A. et Moulé L., Histoire de l’école d’Alfort, Asselin et Houzeau, 1908
M.Tessier, Histoire de l’introduction et de la propagation des mérinos en France, 1838