09/12/2007
CHATOU SOUS LA RESTAURATION 1814-1830
POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE PERIODE MECONNUE DE NOTRE VILLE,
NOTRE BULLETIN HISTORIQUE EST DESORMAIS EN VENTE
AU PRIX DE 10 EUROS, COUT D'UNE ADHESION ANNUELLE
A L'ASSOCIATION CHATOU NOTRE VILLE, BP.22 78401 CHATOU CEDEX
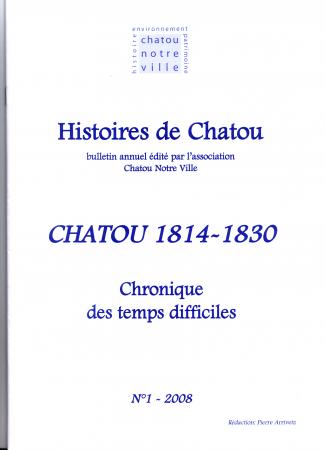
Le recensement de 1817 nous renseigne sur l’activité qui existait dans la commune. Sous le mandat de Monsieur Travault (1814-1823), le village était habité par une population majoritairement paysanne : en comptant les membres de leurs familles, les cultivateurs représentaient 154 habitants, les jardiniers 69 habitants, les vignerons 35 habitants, les bergers 6 habitants. Les propriétaires ou rentiers et leurs familles étaient au nombre de 31 et leurs domestiques 23. Les journaliers et leurs familles étaient 50. La culture était bonne, la pâture précaire.
Le commerce était développé en quatre points de la commune : rue de la Paroisse, où l’on recensait un boulanger, Nicolas Léchalat, (au numéro 17), un charcutier, Joseph Luzard (au numéro 19), deux marchands épiciers, Nicolle Zacharie (au numéro 13) et Jacques Philippe Chassant (au numéro 25), un cordonnier, Jean-Baptiste Cosron (au numéro 12) , un boucher, Laurent Dubois et son fils garçon-boucher (au numéro 14), un tailleur, Etienne Préau (au numéro 25), un aubergiste, Jean Picard (au numéro 1), deux blanchisseuses, Félicité Martin et sa mère, Jeanne (au numéro 17), un perruquier, Jean Etienne François Levanneur (au numéro 1).
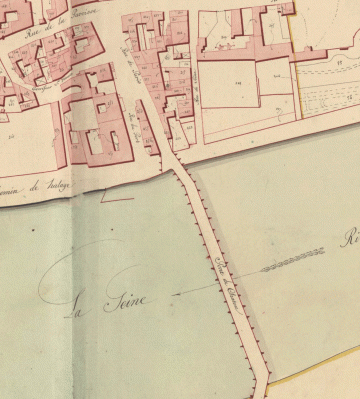
Dans son prolongement rue du Château, se trouvaient deux marchands de fruits, François Denis Pierre (au numéro 8) et Jean-Baptiste Mollé (au numéro 20), ainsi que deux cordonniers, Jean-Baptiste Martin et Nicolas François Luzard (au même numéro).
Le troisième point où les échoppes se multipliaient était la rue de Paris qui menait à l’ancien pont. On y trouvait une repasseuse, Marguerite Juren (au numéro 12), un boucher, Pierre Gavet (au numéro 22), une « marchande », Geneviève Larchevêque (au numéro 5), un débitant de tabac, Etienne Marguery (au numéro 7), un blanchisseur, François Mallet (au numéro 9), une blanchisseuse, Sophie Levanneur (au numéro 8), une marchande de fruit, la veuve Gadiser (toutes deux au numéro 8), une marchande d’eau de vie, Marie Jeanne Decourt (au numéro 9) et un perruquier , Jean-Baptiste Mandois (au numéro 12).
Rue de Saint-Germain étaient recensés trois cordonniers, Jean-Pierre Corret, 63 ans (au numéro 1), Rateau (au numéro 5), Philippe Tranquard (au numéro 23),, Jacques Hélène, voiturier (au numéro 32), Jean Baptiste Trouillet, aubergiste (au numéro 46), Victoire Rateau, couturière (au numéro 2), Louis David, charron (au numéro 4), Charles Hanriot, serrurier (au numéro 13), au numéro 18 Marie-Françoise Levanneur, cuisinière, Louis Haisde, charron et aubergiste, Sylvain Guillerand, charron, Sylvain Boissey, charron, au numéro 23, Laurent Pierre, fruitier,

Les métiers du bâtiment étaient également bien représentés par :
- huit maçons : rue du Château, Sulpice Desnoyers (au numéro 18), rue de la Paroisse, Pierre Marie Huche (au numéro 10), Julien Quesnelle (au numéro 17), rue de Saint-Germain, Joseph Schibleur fils (au numéro 23), rue de la Procession, Jacques Tranquard (au numéro 9), rue de Montesson Jean-Baptiste Maillet (au numéro 2), deux maîtres-maçons, François Debled, 31 rue de Saint-Germain et Jean André Thomas, 22 rue de la Paroisse, ce dernier étant également commandant de la Garde Nationale en 1817 ;
- quatre charpentiers : rue de Saint-Germain, Claude Berthelot (au numéro 26), François Davoust (au numéro 24), Claude Duvignou (au numéro 28), rue du Port, Vincent Desjardins (au numéro 4) ;
- un couvreur, Joseph Greillois, 2 rue de Seine ;
- un menuisier : Nicolas Alexandre Caillot (au numéro 3) ;
- un tailleur de pierre rue de Saint-Germain, Gabriel Dufraisse (au numéro 18) ;
- au 1 rue Bourbon, un vitrier, Jean Charles Bidard.
Le directeur de la poste, Paul Rateau, « propriétaire » de 70 ans, qui officiait déjà avant la Révolution et perdra l’année suivante son bureau transféré sans justification à Nanterre, vivait au numéro 22 de la rue de Paris tandis que le suisse de l’église, Henry Joseph Schibleur, était son voisin, au numéro 20. Le « maître du pont » était Pierre Fournaise, 42 ans et vivait 8 rue de Paris avec les six membres de sa famille.
Au 3 rue du Château habitait le percepteur de la commune, Louis Rousseau, 65 ans. Enfin, au 2 rue Bourbon étaient logés Augustine Angéline Dufaux, institutrice et Pierre Martin Robert Bourdeille, instituteur.
Chatou s’illustra dans la renaissance industrielle du pays. Trois expositions nationales de l’industrie s’étaient tenues dans les galeries du Louvre en 1819, 1823 et 1827. Aux deux dernières, une entreprise de Chatou qui y participait fut récompensée ainsi que nous l’apprennent Touchard et Lafosse dans leur ouvrage « la Seine-et-Oise », paru en 1837 : « on remarque à Chatou la fabrique de bonnets d’Orient, façon de Tunis, de Monsieur Trotry-Latouche, qui a obtenu une médaille d’argent à l’exposition de 1823 et un rappel à celle de 1827. On y voit aussi les beaux troupeaux de Mérinos appartenant à Monsieur le comte de Polignac, et à Monsieur Travault. Ce joli village, situé sur la rive droite de la Seine, est à 3 lieues et demi de Paris, le nombre de ses habitants s’élève à 993. »
La profession de marchand forain en revanche n’était exercée que par un seul Catovien, Guillaume Chevrier, 60 ans, habitant 9 rue de Paris (St-Germain). Notons que la difficulté d’exercer ce métier défiait la volonté de l’Etat et en particulier, celle du duc de Richelieu, ministre de Louis XVIII, qui donna des ordres aux préfets sur le sujet : parmi eux, le baron Des Touches, préfet de Seine-et-Oise, écrivit aux maires de nos communes le 15 janvier 1817 pour les semoncer : « le ministre de l’Intérieur est informé que dans plusieurs villes et communes, l’autorité municipale met à l’industrie des marchands forains et colporteurs, des entraves et des restrictions ; et que même elle va parfois jusqu’à s’opposer à la liberté que la loi assure aux marchands ordinaires, de vendre hors de leur domicile habituel, liberté dont peut jouir tout commerçant dûment patenté.(…)
Les avantages attachés à la concurrence exigent que tous les commerçants puissent, sous la protection des lois, voyager, acheter, contracter et négocier leurs engagements partout où ils se trouvent La faculté de vendre est expressément garantie par l’article 38 de la loi du 22 octobre 1798 relative aux patentés qui exposent leurs marchandises en vente hors de leur domicile. Cette disposition n’est qu’une conséquence de celle de l’article 27 portant « tout citoyen muni d’une patente pourra exercer sa profession ou industrie dans toute la France… ».
La loi a distingué les colporteurs avec voiture sous le nom de marchands forains, les colporteurs avec bête de somme et les colporteurs à balle : ces deux derniers sont dispensés de droit proportionnel, même dans le lieu de leur domicile. L’intérêt qu’ont les manufactures à travers le placement des produits de qualité inférieure, et celui de la classe des consommateurs qui, par l’exiguïté de leurs moyens, sont obligés de se contenter de ces produits, ont fait accorder une protection constante à cette profession ; et l’autorité ne doit pas souffrir qu’il soit porté atteinte aux lois qui la protègent (..)
Déterminer pour les marchands étrangers la durée de leur séjour, ou le temps pendant lequel ils peuvent vendre serait une mesure arbitraire à laquelle il faut absolument éviter de se laisser entraîner. Cette mesure a été constamment blâmée par les ministres et mérite de l’être (…). »
L’évolution a donné lieu depuis à une « révolution » dans les commerces de bouche puisque l’on trouve aujourd’hui peu de marchands forains qui ne vendent de produits de qualité « supérieure ».
Un arrêté du préfet obligeait les aubergistes et les « logeurs » à tenir un registre «de suite et sans aucun blanc sur un registre en papier timbré et paraphé par le maire » indiquant les « qualité, domicile, date d’entrée », ledit registre devant être présenté tous les quinze jours au maire et chaque fois qu’il le demandait. Sans respect de ces prescriptions, le commerçant était condamné en 1823 à une amende équivalent au quart de son droit de patente.
Enfin, plusieurs Catoviens étaient sans nul doute associés aux gloires militaires de l’Empire et devaient subir le déclassement que leur imposait la Restauration : tels, en 1821, Louis Honoré Desjardins, 43 ans, chef de bataillon en retraite habitant 22 rue du Chateau, Commandeur de la Légion d’Honneur, Claude Charles Blin, 50 ans, habitant 12 rue de la Procession, capitaine en retraite, Chevalier de la Légion d’Honneur, Michel Jacquin, 40 ans, militaire en retraite, vivant 2 rue du Port, Pierre Etienne Goussard, 41 ans, 15 rue de la Paroisse, militaire en retraite, Chevalier de la Légion d’Honneur.
Les marchés servaient d’approvisionnement, mais le marché de Chatou ne fut institué qu’en 1860, de sorte que les commerçants ou les particuliers devaient faire un voyage pour se procurer les divers produits : en consultant l’Annuaire de Seine-et-Oise pour l’année 1824, on se rend compte que les deux villes les plus proches pour les marchés étaient Saint-Germain-en-Laye et Versailles.
A Saint-Germain-en-Laye se tenaient le lundi un marché de « grains et porcs » et le jeudi, un marché de « grains et denrées » tandis qu’à Versailles se tenaient un marché de « grains, fourrages et denrées » le mardi et un marché de « grains, fourrages, marée, volailles et denrées » le vendredi. Deux foires annuelles se tenaient également à Saint-Germain, aux Loges, en août et en septembre : une foire aux « comestibles » et une autre aux « toiles, mercerie, modes, quincaillerie ».
Quant à la situation générale des revenus dans la commune, il suffit de s’en rapporter aux dires du conseil municipal le 4 avril 1825, lorsque fut stigmatisé auprès du préfet « l’état infiniment modique des revenus de la commune, composé par la presque généralité de ses habitants d’hommes de peines, propriétaires d’un terrain infiniment divisé et de petite culture propre pour les deux tiers au moins exclusivement aux plantes légumineuses et pour l’autre tiers à la culture hasardeuse de vignes médiocres. »
Comment imaginer dans le Chatou du XXIème siècle que le premier accident climatique privait une partie des habitants de leur maigre revenu ? ce fut pourtant le cas en 1819, lorsque le maire annonça au conseil municipal en plein mois de mai que la gelée avait endommagé les vignes et les champs semés en pois et haricots, ainsi que les cerisiers, « que ce pays étant de petite culture, nombre d’habitants ont perdu tout espoir de récolte et qu’il serait intéressant d’en faire part à Monsieur le Préfet pour qu’il nomme les commissaires chargés d’examiner les lieux endommagés et obtenir soit une indemnité, soit un dégrèvement de contribution. »
L’autorité municipale répondait à plusieurs titres de l’exploitation agricole : le maire ou son adjoint prescrivait par arrêté la date d’ouverture du ban de vendange en la faisant ratifier par les propriétaires vignerons.
Dans l’arrêté du 2 octobre 1823, ils étaient dix-sept propriétaires à y souscrire pour une date fixée au 9 octobre suivant. Le 7 janvier 1823, une plainte fut adressée par un membre du conseil municipal : « depuis trop longtemps, on ne forme ni angelus dés le matin ni aux autres heures du jour, ce n’est pas seulement sous le rapport religieux ajouta-t-il que cet excellent et antique usage a été établi le matin, à midi et le soir. Les ouvriers vignerons et autres cultivateurs ont fait de cet usage la règle du départ, de la suspension et du retour de leurs travaux. »
Depuis la fin de la sonnerie, « on ne sait plus à quoi s’en tenir, les travaux en souffrent et les plaintes se multiplient ». Un autre conseiller ajouta que l’on devait reconnaître que celui qui en était chargé n’était « pas assez payé » et que le maire devait mettre la question sous les yeux du préfet en demandant la sonnerie dés « trois heures du matin en été et cinq heures en hiver ».
Ajoutons que la municipalité joua un rôle déterminant à la Révolution pour la mise en valeur d’un quartier de la ville dont le nom nous est familier : celui des Landes, encore appelé « les Nouvelles Communes » parce que les parcelles appartenaient à la commune de Chatou.
Les 1er et 8 septembre 1793, un procès-verbal avait été établi par les habitants réunis en assemblée générale. Il y était dit que ces terrains alors en landes et en bruyères avaient été divisés en 1789 en lots de 8 ares 54 centiares (25 perches) et répartis « entre une grande partie des chefs de famille de la commune » contre une redevance annuelle « par suite des adjudications consenties par les maires et officiers municipaux d’alors ».
Les entraves causées par la révolution empêchèrent la réalisation des contrats promis aux habitants. Les habitants intéressés les défrichèrent néanmoins à grands frais et y plantèrent arbres fruitiers et vignes. C’est pourquoi l’assemblée générale de 1793 reconnut leur possession. Dans une délibération du 29 avril 1806, il fut reconnu que ces « communaux » étaient « d’une mauvaise ou médiocre nature, que le produit annuel ne pouvait excéder la nature de 20 F par arpent et que d’après l’article 3 de la loi du 9 ventôse an 12, ce produit devait être réduit à 10 F remboursable au principal de 200 F ».
Le 11 mars 1813, un nouveau procès-verbal dressé par un certain Monsieur Guy avait constaté le vœu unanime de donner ces terrains à bail à 99 ans contre une redevance annuelle payée sur les bases du procès-verbal de 1806.
Après 31 ans et le paiement de la redevance par la quasi-totalité des propriétaires, le conseil municipal, réuni à la demande du préfet le 5 mars 1820, jugea que si c’était un acte de justice de maintenir la possession compte-tenu des travaux et frais engagés, c’était également un moyen pour la commune de s’assurer une source de revenus fixes contrairement aux locations ordinaires.
Les modalités d’exploitation des terrains furent ensuite redéfinies : les possesseurs ne pourraient céder leurs droits sans le consentement de la commune sauf à leurs héritiers, les terrains seraient impérativement plantés de vignes et d’arbres fruitiers dix ans avant la fin de leur jouissance, une hypothèque serait prise sur le bien des preneurs qui paieraient les frais et honoraires des baux et leur inscription, ainsi qu’une somme de 12 F par arpent versée à la commune notamment pour les opérations de bornage.
S’il s’avérait qu’un postulant ne remplissait pas ces conditions, le conseil municipal lui désignerait un remplaçant. Le maire recevait la charge de signer ces baux devant notaire.
Parmi les exploitants agricoles figurait l’Hospice de Paris. Possédant des terrains dans « la Petite Ile », l’institution procéda le 30 juin 1824 à une vente aux enchères sous l’égide de Monsieur Jean-Baptiste Mallan, inspecteur des biens de l’Hospice, de deux pièces de pré d’1,50 hectares. Mises à prix pour un montant de 123,60 F, celles-ci furent acquises par Monsieur Décamp pour 180 F.
S’agissant de l’exercice du maraîchage, nous invitons le lecteur à découvrir le « Pavillon d’histoire locale » ouvert dans les communs du château Chanorier par l’association « la Mémoire de Croissy » dans la commune voisine de Croissy-sur-Seine. On y expose les techniques ancestrales et l’activité des cultivateurs de la région. Retenons cependant qu’en 1823 un recensement vint témoigner que trente habitants de Chatou possédaient une charrette et cent quinze une bête de somme.
Le prix d’une journée de travail était fixé par l’Etat selon les revenus des villes par une ordonnance de 1820. Ainsi en 1829, si le prix d’une journée de travail ne pouvait être inférieur à 1,50 F à Versailles, commune de la première classe, il tombait à 90 centimes au Pecq, Mesnil-le-Roi et à Mareil-Marly, communes de la quatrième classe, et à 80 centimes dans les communes de la cinquième classe, Chatou, Croissy et Maisons-sur-Seine.
| 00:20 | Commentaires (0) | Lien permanent








