25/10/2007
PAVILLON DE GARDIEN SECOND EMPIRE
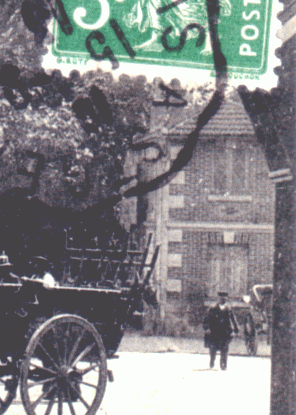
Ce petit pavillon de gardien élevé à la gare de Chatou sous le Second Empire en même temps que la très belle villa pierre et briques aujourd’hui rénovée est actuellement condamné à la destruction par le PLU , celui-ci prévoyant un emplacement réservé pour la création d’une gare routière (plan 4-2-3 du PLU) . Compte-tenu de sa situation exceptionnelle et de son décor de briques si caractéristique, il serait bien plus intéressant de le conserver pour y aménager un office du tourisme qui fait défaut et un service culturel.
Quant à la gare routière, elle pourrait parfaitement s’installer sur le parking du bureau de la SNCF rue Paul Flament à condition de supprimer sur cet emplacement la zone de constructibilité de 16 mètres de hauteur avec 80% d’emprise au sol dans le PLU (art.UC.9.2 et U.C.10.2 du règlement du PLU)...
Publié dans # PATRIMOINE MENACE | 23:40 | Commentaires (0) | Lien permanent
15/10/2007
LES DENOMINATIONS DE RUE
Quai entre Carrières et le pont routier : quai Bertin le 7 novembre 1847 (dénomination sans postérité, quai du Nymphée actuel)
Quai entre le pont routier et la rue Bourbon : quai Bourbon le 7 novembre 1847 (dénomination sans postérité, quai de l'amiral Mouchez actuel)
Voie nouvelle créée entre la rue du Chemin de Fer, traversant le canton dit "des Chardrottes" et la propriété de la Faisanderie jusqu'au hameau du Vésinet territoire de Chatou, créée par monsieur de Brimont. Son ouverture est constatée par le conseil municipal le 24 avril 1853 : l'usage et non une délibération particulière du conseil en fera "l'avenue de Brimont".
Quai de la rue Bourbon au pont de chemin de fer : quai des Papillons le 7 novembre 1847 (dénomination sans postérité, quai Jean Mermoz actuel)
Voie nouvelle entre la rue des Calêches et l'actuelle rue de l'abbé Borreau : rue des Chardrottes ouverte le 17 juin 1848 et baptisée rue des Ecoles le 3 octobre 1868, prolongement jusqu'à l'avenue de Saint-Germain baptisé du même nom le 11 août 1869
Avenue du Vésinet : avenue du Parc le 17 novembre 1867
Rue du Chemin Vert : rue Labélonye le 20 mai 1878
Voie ouverte entre la rue de Sahûne et la rue du Chef Saint-Jean : rue des Dix-Sept le 19 décembre 1880
Avenue de la Rivière : avenue Larcher le 19 octobre 1882
Avenue Lacroix : rue Esther Lacroix le 12 avril 1884
Avenue de Flandre : boulevard de la République le 12 avril 1884
Rue de la Procession : rue de la Liberté le 12 avril 1884
Avenue du Vésinet : avenue Victor Hugo le 12 avril 1884
Création de la rue Charles Lambert entre la rue de la Gare et la rue François Arago le 14 mai 1897
Rue de la Tranchée : rue du Lieutenant Ricard le 27 juin 1910
Rue du Centre : rue Brunier-Bourbon le 12 août 1911
Rue de Croissy : rue du Général Colin le 23 mars 1918
Rue Verte : rue Charles Despeaux le 21 décembre 1918
Rue des Sablières : rue du Général Galliéni le 2 décembre 1920
Ancienne rue Bourbon : Quai de l'Amiral Mouchez le 17 février 1921
Rue Nouvelle : rue Brunier-Bourbon le 17 novembre 1921
Rue des Chardrottes : rue du Capitaine Guynemer le 15 novembre 1922
Rue Transversale de la Place : rue Deloigne le 15 novembre 1922
Petite Rue Sous-Bois : rue Lantoine le 15 novembre 1922
Chemin des Vaches : rue Darcis le 15 novembre 1922
Rue des Pissis : rue Beaugendre le 15 novembre 1922
Rue de la Ferme Prolongée : rue Albert Joly le 13 février 1930
Voie ouverte à hauteur du boulevard Jean Jaurès : chemin de l’Avenir le 10 novembre 1931
Rue des Calêches : rue Georges Clémenceau le 13 février 1931
Rue des Gabillons : rue de la Gare en 1878 puis avenue du Maréchal Joffre le 13 février 1931
Rue du Saut du Loup : rue de l'Abbé Borreau le 13 février 1931
Voie ouverte entre le carrefour de la Route de Montesson (rue du général Leclerc) et le chemin des Larris (rue Léon Barbier) : rue Ribot le 10 novembre 1931
Avenue des Vaucelles : avenue Paul Doumer le 11 août 1932
Avenue des Chalets : avenue Aristide Briand le 11 août 1932
Rue des Cormiers Prolongée : rue Tournier le 11 août 1932
Voies nouvelles crées entre la route de Montesson (rue du général Leclerc) et la route de Maisons : rue Audéoud Fournier (disparue en 2006), rue Paul Painlevé, rue du Professeur Calmette, place du docteur Roux le 7 novembre 1933
Villa des Landes : rue Edmond Flamand le 6 décembre 1936 rebaptisée allée Edmond Flamand le 28 février 1937
Voie entre la rue Sainte-Marie et l'avenue Larcher : quai Jean Mermoz le 28 février 1937
Rue des Jardinets : rue Maurice Hardouin le 13 juin 1937
Rue Centrale : rue Emile Pathé le 22 août 1937
Square construit en 1938 entre la route de Montesson (rue du général Leclerc) et la rue des Beaunes : square Debussy le 16 octobre 1938
Voie nouvelle créée le long des usines Pathé longeant le cimetière et reliant la rue Emile Pathé à la rue du Lieutenant Ricard : rue Edouard Branly le 12 mars 1939
Avenue du Château de Bertin dans le Parc de Chatou baptisée le 12 mars 1939
Chemin de halage entre le pont routier et la rue Esther Lacroix (à hauteur du barrage de la Seine) : quai "de la Nymphée" le 1er octobre 1939 finalement changé en Quai du Nymphée
Publié dans L'AMENAGEMENT DE CHATOU | 21:40 | Commentaires (0) | Lien permanent
12/10/2007
LA PASSERELLE DU PONT ROUTIER EN JUILLET 1940
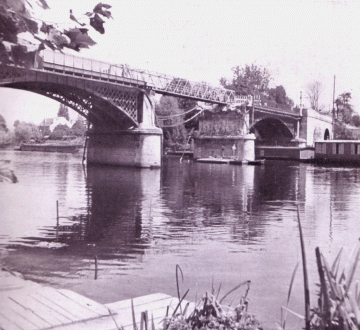
Le pont routier de Chatou avait été dynamité par l’armée française peu avant l’arrivée des allemands, ressuscitant pour les Catoviens l’usage antique du bac pour traverser les rives de la Seine. L’invasion perpétrée, la municipalité fit établir une passerelle métallique (ci-dessus). Une affiche à chaque entrée prévint : « La passerelle de Chatou ne peut porter que vingt personnes espacées tous les deux mètres. Au-delà, danger mortel. Le passage des voitures de plus de 500 kilos est interdit aux heures d’affluence. »

La passerelle de Chatou en juillet 1940. Désormais la liaison entre Paris et Chatou serait placée sous le signe de la nécessité et du couvre-feu.
Publié dans CHATOU ET LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE | 23:20 | Commentaires (0) | Lien permanent
09/10/2007
LES BOMBARDEMENTS SOUS L'OCCUPATION
Bombardement du 3 mars 1942 (allié)
Rapport du lieutenant commandant la subdivision des sapeurs-pompiers :
« le mardi 3 mars 1942, vers 21 heures, alerté par la présence dans le ciel de très nombreuses fusées éclairantes et par quelques bruits assourdis, j’ai immédiatement pris la décision de me rendre à mon poste de commandement à la mairie où je suis arrivé vers 21h10.
La situation paraissant devoir s’aggraver, j’ai immédiatement fait appel au piquet de service. Celui-ci était réuni au complet au poste vers 21h30. Pendant la durée des bombardements , environ deux heures, j’ai contrôlé au mieux les directions d’éclatements de bombes ainsi que la position des fusées éclairantes par rapport au territoire de Chatou.
Ces fusées paraissaient former un cercle dont le centre pouvait se situer au fort du Mont Valérien. Je crois qu’au moins six vagues d’avions se sont succédées au cours des bombardements.
Vers 23 heures, une bombe de fort calibre est tombée en Seine au droit de l’église. Je me suis rendu immédiatement sur les lieux. J’ai eu le regret de constater que les habitants ne tenaient aucun compte des avis réitérés de la Défense Passive, circulaient sur le Quai de l’Amiral Mouchez au risque d’être blessés par les projectiles lancés par la DCA allemande. Vers 23h15, Monsieur Boisserie s’est présenté accompagné d’une vieille dame blessée par des éclats de verre, elle a été immédiatement pensée par Mademoiselle Thomas, pharmacienne.
Les bombardements ayant pris fin à 23h55, j’ai invité le personnel de mon piquet à se rendre dans les divers quartiers où la chute de bombe avait été signalée.
Des rapports qui m’ont été fournis et que je confirme pour m’être rendu sur place par la suite, il appert :
1°) Quartier du Pont et de l’Ile de Chatou :
3 bombes sont tombées sur ce quartier
- 1 en Seine au droit de l’église où les vitraux ont été sérieusement endommagés
- 1 autre dans l’Ile de Chatou à proximité immédiate du pont route, celles-ci causant de sérieux dégâts à des hangars des entreprises chargées de la construction de l’émissaire Sèvres-Achères
- la 3ème également dans l’Ile mais beaucoup plus loin
La déflagration consécutive à l’éclatement de ces bombes a provoqué le bris de très nombreuses vitres et le soufflage de toitures, notamment dans le chemin du Bac
2°) Avenue Gambetta :
- 1 seule bombe de fort calibre a éclaté au droit du n°10 de cette voie. Dégâts matériels assez importants, notamment aux immeubles ci-après :
- n°10, Monsieur Mandrin, propriétaire
- n°23, Monsieur Riaggi
- n°27, Madame veuve Pottot
Soufflage de toitures et bris de vitres dans tout le quartier.
3°) Chemin des Vignobles :
Chute de 7 bombes à proximité également de 3 petites habitations de Messieurs Jedresko, Urida, Bauer.
Après cette visite, j’ai toutefois maintenu sur place mon piquet. A 11h05, monsieur le commissaire de police par l’intermédiaire du brigadier Turpin m’a fait connaître que la commune de Montesson demandait du secours pour lutter de concert avec les sapeurs-pompiers de Montesson contre l’incendie qui ravageait les usines Bénet, route de Sartrouville. »
D'autres bombardements atteignirent Chatou mais nous sommes obligés faute de documentation suffisante d'en faire mention pour mémoire.
Bombardement du 31 décembre 1943 (allié)
Ce bombardement est signalé sans détail dans le registre des délibérations du conseil municipal. On apprend seulement que la voie ferrée a été touchée mais qu'elle a été rétablie dans un "temps record".
Bombardement du 2 septembre 1944 (allemand)
Une fusée de type V1 tomba sur la villa Lambert, détruisant deux maisons et faisant deux blessés légers.
A suivre
Publié dans CHATOU ET LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE | 00:15 | Commentaires (0) | Lien permanent
06/10/2007
1944 : UN "GRAND PATRIOTE"
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Chatou du 10 septembre 1944 :
« Le Comité de Libération de Chatou demande instamment au gouvernement provisoire de la République d’autoriser le retour en France du grand patriote qu’est Maurice Thorez. Monsieur Thorez qui a dû, pour pouvoir continuer à diriger le combat anti-hitlérien, se soustraire aux menaces précises d’incarcération que faisait peser sur lui le gouvernement Daladier, organisateur de la défaite en 1940, en faisant arrêter les meilleurs militants ouvriers, ne peut, bien au contraire, être considéré comme un déserteur. Monsieur Thorez, homme politique inattaquable, est un grand Français qui doit reprendre sa place parmi nous. »
N.B : aprés la signature du pacte germano-soviétique, le parti communiste est interdit en France le 26 septembre 1939. Le secrétaire de l'Internationale Communiste, Dimitrov, envoie un télégramme au secrétaire général du PCF, Maurice Thorez, pour lui demander de déserter. Thorez arrive à Moscou le 8 novembre 1939. Il y restera jusqu'à la Libération.
Publié dans CHATOU ET LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE | 19:20 | Commentaires (0) | Lien permanent
MARIANNE MALMENEE
Le 8 novembre 1942, le maire Monsieur Ramas rappela qu’au mois d’août le buste de la République avait été enlevé à son insu de la salle du conseil municipal et qu’il l’avait fait remettre en place dés qu’il eut connaissance de la soustraction commise. Diverses lettres anonymes lui ayant été adressées tendant à l’enlèvement du buste, ainsi que par un membre du conseil municipal, Monsieur Tassart du conseil écrivit au préfet. Le secrétaire de préfecture fit cette réponse qui peut nous paraître étrange aujourd’hui : « j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’au terme des directives adressées par Monsieur le Préfet délégué du Ministre de l’Intérieur, il n’y a pas lieu de procéder au retrait du buste de la République dans les édifices publics, la forme du gouvernement n’ayant pas été modifiée constitutionnellement. »
(in Registres des délibérations du conseil municipal)
Publié dans CHATOU ET LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE | 19:05 | Commentaires (0) | Lien permanent
30/09/2007
LES RUES DETRUITES AVEC LA RENOVATION


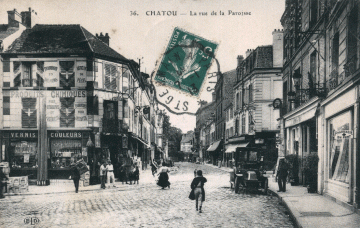
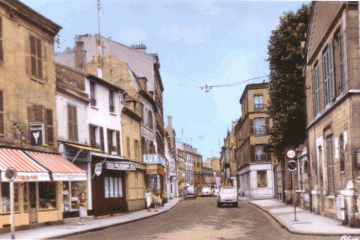

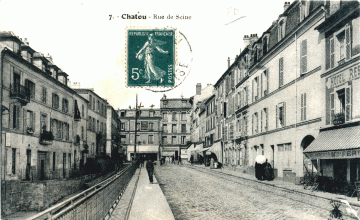
Publié dans # PATRIMOINE DETRUIT | 23:10 | Commentaires (0) | Lien permanent
LA VILLA DE CHARLES LAMOUREUX

Publié dans # PATRIMOINE DETRUIT | 10:05 | Commentaires (0) | Lien permanent
29/09/2007
LE SEUL CHEF D'ETAT EN VISITE OFFICIELLE A CHATOU
Chatou n’a connu dans son histoire la visite officielle que d’un seul chef d’Etat. Il s’agit du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en campagne électorale, qui fut reçu avec acclamations le 5 octobre 1850 par le village avec à sa tête son maire Tony de Brimont.


| 17:30 | Commentaires (0) | Lien permanent
15/09/2007
L'ANCIEN CINEMA ART DECO DE CHATOU PROMIS A LA DESTRUCTION

La salle des ventes rue du Général Colin fut l'ancien cinéma de Chatou construit en 1925 par Messieurs Weiner et Certain, habitants de Croissy et du Vésinet, sur les plans de l’architecte Lucien Desgrivan et par l’entreprise A.Tschoffen et Compagnie. D’abord dénommé Magic-Ciné, il fut repris en 1935 et s’appela l’Olympia. Il fut arrêté en 1976 lorsque fut construit le centre Jacques Catinat et depuis est devenu une salle des ventes. Contemporaine de l’exposition des Arts Décoratifs de Paris de 1925, son architecture en fait un témoignage intéressant l’inventaire de notre ville qui mériterait au contraire d'être mis en valeur.
Malheureusement, la règlementation actuelle du Plan Local d'Urbanisme voté le 9 novembre 2006 le condamne à la destruction : il a été placé dans une zone URB avec une emprise au sol autorisant la constructibilité sur 100% de la superficie du terrain (art.UR.9 du règlement du PLU) avec une hauteur autorisée jusqu'à 16 mètres (art.UR.10 du règlement du PLU). Aprés l'usine Pathé-Marconi (1929) démolie grâce à la règlementation municipale, ce sera donc le deuxième et dernier témoignage Art Déco de Chatou qui disparaîtra.
Publié dans CHATOU DANS LE CINEMA | 16:50 | Commentaires (0) | Lien permanent








